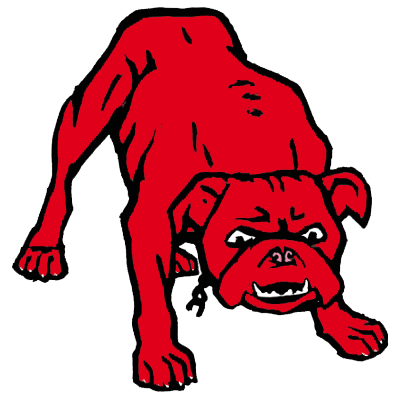Récupération sécuritaire
Qui poignarde vraiment l’école ?
Le 10 juin dernier, aux abords du collège de Nogent en Haute-Marne, un élève de 14 ans surine une Assistante d’éducation (AED). Les flics sur place procèdent à des fouilles de sacs aléatoires lorsque Mélanie Grapinet, 31 ans, est poignardée. Elle décède peu après. Un membre de l’État islamique ? Un jeune sous influence frériste ? Raté, l’auteur des faits a 14 ans, n’est pas racisé, et n’a pas de mobile particulier. Des plateaux télé au sommet de l’État, l’habituel refrain essentialisant ne marche plus. On invoque vaguement les jeux vidéo ou les réseaux sociaux comme causes possibles et on propose davantage de sécuritaire à l’avenir. On fait cependant peu de cas de la situation des AED et du personnel de l’Éduc nat’, en sous-effectif, précaire et souvent peu formé. On a discuté de l’évènement, de ses récupérations et des pistes (de gauche) pour une école plus apaisée avec deux membres de Sudéduc 13 : Victor et Rémi, respectivement AED et instituteur à Marseille. Entretien.
⁂
En tant que personnels de l’Éduc nat’, quel est votre premier sentiment quand vous apprenez la mort de Mélanie Grapinet ?
« Mélanie Grapinet est morte sur son lieu de travail, les causes sont aussi à aller chercher de ce côté-là »
Victor « La colère d’abord. J’ai appris sa mort par les médias classiques. La récupération et la déformation des faits étaient déjà enclenchées. Les médias discutaient de “renforcer” davantage la sécurité aux abords des établissements, d’y mettre des portiques de sécurité. Le jour même, l’institution disait plus ou moins la même chose. À la télé, Bayrou déclarait vouloir limiter la vente de couteaux sur internet et Macron proposait d’interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans... Les collègues en vie scolaire exprimaient la même colère que moi, on avait tous l’impression que les réponses étaient à côté de la plaque. » Rémi « Très vite, cet événement a été qualifié de “fait divers”. C’est dépolitisant et ça permet d’évacuer le contexte. Mélanie Grapinet est morte sur son lieu de travail. Les causes sont aussi à aller chercher de ce côté-là. Depuis fin mars, la circulaire Borne-Retailleau [écrite conjointement par les ministères de l’Éducation et de l’Intérieur, ndlr] permet aux préfectures de déclencher des fouilles aléatoires devant les établissements jugés “tendus”. À Marseille, certains policiers cagoulés ont procédé à des fouilles de collégiens de onze ans, toujours dans des quartiers défavorisés. On stigmatise l’élève comme danger potentiel. Et cela produit toujours plus de tensions ! »
Pourquoi, d’après vous, les médias et le pouvoir s’enfoncent dans le tout sécuritaire ?
« À Marseille, certains policiers cagoulés ont procédé à des fouilles de collégiens de onze ans, toujours dans des quartiers défavorisés »
V « D’après moi, cela permet de nier les responsabilités. Les médias parlent d’insécurité à longueur de journée, du fait qu’il faut se défendre, que le danger est partout. Pas étonnant que certain·es jeunes sortent armé·es ! La dégradation de l’institution scolaire joue également un rôle crucial dans le mal-être des jeunes. Moins de personnel, des classes surchargées. Cela accentue la maltraitance envers les élèves. Se focaliser sur le couteau permet de faire porter la responsabilité sur l’extérieur : les parents ou les enfants eux-mêmes. » R « Le pédagogue Eric Debordieux a montré que depuis 30 ou 40 ans, les violences à l’école n’avaient pas augmenté [voir encadré]. Les réponses sécuritaires elles, n’ont cessé de se multiplier. Cela permet d’occulter également la réalité de l’Éducation nationale. Depuis des décennies, on baisse les budgets et dégrade les conditions de travail, ce qui impacte forcément les relations entre les élèves et le personnel. Les AED sont recruté·es par CDD d’un an renouvelable. Iels sont très mal payé·es [le SMIC, ndlr], souvent peu formé·es et peu considéré·es. »
Comment se fait-il d’après vous que ce drame ne suscite que peu de réactions autant du côté de la société civile que du corps professoral ou des organisations de gauche ?
« Les médias parlent d’insécurité à longueur de journée, du fait qu’il faut se défendre, que le danger est partout : pas étonnant que certain·es jeunes sortent armé·es ! »
V « Bien sûr, l’effet “fin d’année” joue, mais il y a d’autres facteurs. Premièrement, le sexisme et le classisme. Mélanie Grapinet n’était pas un homme professeur, mais une femme précaire, une “petite main” de l’Éducation nationale, ce qui suscite peu d’intérêt, y compris de la part des enseignant·es. J’y vois aussi une sorte d’islamophobie renversée : ce meurtre n’a pas été revendiqué par une idéologie [l’assassinat de Samuel Paty avait été revendiqué par l’État islamique, ndlr], il ne s’inscrit pas dans un “combat civilisationnel contre la barbarie”, donc ça ne mobilise pas les franges réactionnaires »
Dans l’idéal, quelles solutions peut-on imaginer pour assurer de meilleures relations entre les élèves et le personnel ?
R « À SUD, on milite pour la création d’un poste d’éducateur scolaire avec un statut de fonctionnaire publique. Cela permettrait de revaloriser le métier, de sortir les AED de la précarité et de leur fournir une vraie formation. L’éducateur·ice serait alors un·e acteur·rice référent·e dans le parcours des élèves. On milite aussi pour des classes moins chargées ou l’arrêt du financement des écoles privées par le public [l’État les finance à 75 %, ndlr]. À Marseille, par exemple, les élèves qui ont de bonnes conditions matérielles échappent à l’école publique, ce qui participe à la ghettoïser. Au contraire, l’école devrait être mieux connectée à l’extérieur. Avec les centres sociaux, les psys, elle devrait être au centre d’un maillage de services publics qui permettrait de mieux accompagner les jeunes. Cela nécessite évidemment des changements d’ordre plus globaux et des luttes qui engagent la société tout entière. À propos de la mobilisation, si elle reste faible, tout l’enjeu va d’être de raviver l’élan à la rentrée autour de nos thèmes : ne pas laisser le tout sécuritaire s’imposer. »
L’élève comme bouc émissaire
Dans Zéro Pointé. Une histoire de la violence politique à l’école (Les liens qui libèrent, 2025) le pédagogue Éric Debarbieux s’intéresse à la violence au sein de l’école et aux politiques répressives contre les élèves, moyen privilégié pour l’endiguer. Depuis 60 ans, onze personnes ont été tuées à l’école. Sans minimiser ces événements dramatiques, le pédagogue propose de dézoomer. On y découvre que la violence à l’école c’est d’abord entre adultes. Les profs disent subir davantage de harcèlement de la part de leur direction et des parents que de la part des élèves. La violence est également institutionnelle, quand les réformes s’enchaînent et qu’on abandonne souvent le personnel sur le terrain : moins de formations, précarité... Enfin le harcèlement entre élèves, qui vise souvent les minorités, constitue une part importante de la violence à l’école. L’intérêt pour ce thème émerge au début des années 1990, avec comme seule focale l’élève et le danger qu’il ferait peser sur l’institution. Les politiques font alors des « plans » anti-violence afin de « protéger » les établissements. L’Éduc nat’ travaille maintenant étroitement avec la police et la justice. Et si de brefs intérêts pour le harcèlement ont pu émerger par la suite, la focalisation sur la dangerosité présumée des élèves continue jusqu’à aujourd’hui, avec une tendance à « ethniciser et racialiser la violence scolaire ». L’auteur s’inquiète : comment endiguer les violences quand l’école abandonne la lutte contre le sexisme et le racisme qui alimentent le harcèlement1 ? Comment l’élève peut-il maintenir un rapport sain à l’autre quand les idées réactionnaires, qui refusent les droits des minorités, sont maintenant légitimes ? Enfin, le contexte géopolitique, marqué par un désintérêt pour la vie des personnes non blanches, met ces derniers en danger dans les cours d’école comme devant l’institution. Alors, c’est qui les violents ?
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Comme ce fut le cas en 2014 au moment de la polémique autour de l’ABCD de l’égalité, programme qui visait à lutter contre les stéréotypes de genre à l’école. Il a finalement été abandonné après la mobilisation d’association de parents et de partis politiques comme l’UMP (ex-Les Républicains).
Cet article a été publié dans
CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Dans ce numéro d’été, on se met à table ! Littéralement. Dans le dossier d’été, CQFD est allé explorer les assiettes et leur dimensions politiques... Oubliés le rosé et le barbeuc, l’idée est plutôt de comprendre les pratiques sociales autour de l’alimentation en France. De quoi se régaler ! Hors dossier : un mois de mobilisation pour la Palestine à l’international, reportage sur le mouvement de réquisition des logements à Marseille, interview de Mathieu Rigouste qui nous parle de la contre-insurrection et rencontre avec deux syndicalistes de Sudéduc’ pour évoquer l’assassinat d’une Assistante d’éducation en Haute-Marne...
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Par
Illustré par Maïda Chavak
Mis en ligne le 05.07.2025
Dans CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Derniers articles de Étienne Jallot