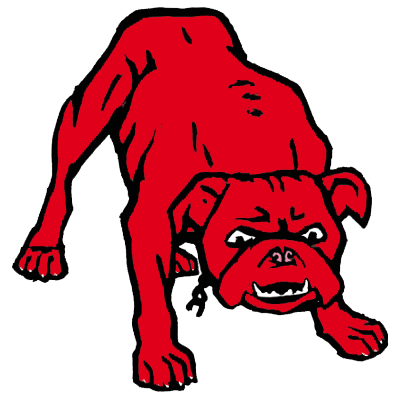Flow de Camargue
Rap des champs
« Les incompris de la société, un peu à côté, ça n’appartient pas qu’au quartier ! » raconte Nono, proche de la trentaine, les yeux brillants. Il se remémore son adolescence depuis son petit village de Camargue, quand lui et ses copains d’enfance ont découvert le rap. « On faisait des freestyles toute la nuit, on parlait de nous, de nos angoisses de jeunes, nos espoirs aussi, puis il y a eu les morceaux ensemble, les concerts. On était habités. » Et dans les campagnes, ils n’étaient sûrement pas les seuls. En décalage avec le village et ses traditions, loin des radars des villes et des maisons de disque, le rap a aussi fait germer sa génération de rappeurs. Mais jamais facile d’assumer cette identité de village quand le rap est plus souvent identifié aux grands ensembles qu’aux grands espaces… Défaitistes pour autant les bouseux ?
« Quand on a découvert le rap, on n’avait pas forcément conscience de son héritage, mais ça nous a tout de suite parlé » racontent Val et Jo, alias Bonobo et Kod.a.ma, qui découpent des instrus depuis une quinzaine d’années. Eux deux ont grandi dans des petits villages camarguais à 20 kilomètres à l’est de Montpellier, où le folklore local tourne plutôt autour des courses de taureaux et des fêtes de villages biturées.
« Tu te reconnais assez facilement dans le rap de cité. Le fait d’être excentré, de se faire chier, de voir toujours les mêmes têtes »
Dans les années 2000-2010 via les jeux vidéo, la radio, internet ou les séries américaines, le rap s’invite sur les télés familiales et dans les chambres d’ados. « C’était un autre univers, plus urbain, qui nous attirait. Sûrement car on faisait tache au village : on traînait au skatepark, on était bizarre. Moi, je suis fils de prof, donc “cultivé”, en décalage avec la mentalité villageoise », confie Val. Jo, d’un milieu moins petit-bourgeois, ne se retrouve pas non plus dans les traditions taurines : « C’était abstrait car nos parents ne venaient pas du coin. » Pour tromper l’ennui et l’impression de tourner en rond, entre le skatepark et le terrain de foot, le rap est un jeu : « Faire des rimes, se moquer des uns et des autres. Ça nous liait tous ensemble. » Et pourquoi pas le rock, le scrabble ou la danse classique ? « Tu te reconnais assez facilement dans le rap de cité. Le fait d’être excentré, de se faire chier, de voir toujours les mêmes têtes. Les city stades, il y en a aussi dans les petits bleds ! » explique Jo. Pour Val, ça se situe aussi sur le terrain des problèmes sociaux : « La drogue est aussi très présente dans les campagnes. Les femmes battues, les voisins qui pètent les plombs… On connaît ça aussi. Et puis le rap véhicule un certain esprit de révolte dans lequel on se reconnaissait. »
Mais comment s’approprier une culture, tout sauf campagnarde, sans faire une mauvaise copie ? « Au début on s’imaginait pas le partager, on faisait ça en cachette », raconte Val. Car difficile d’être pris au sérieux « quand tu corresponds pas à l’image du rappeur de banlieue. Même si plein de gens écoutaient du rap au village, 50 Cent, Eminem… C’était pas nous ! » Et puis un jour, « Orelsan débarque avec un rap de villageois assumé. On se dit “Y’a des mecs dans des bleds à l’autre bout de la France qui font pareil ! On a le droit de montrer notre rap !” », résume Jo.
Ces morceaux sentent la « Brousse » et on se perd dans le « No man’s land »
Sur le terrain d’une des mamans de la bande, ils installent un studio dans une caravane. « Petit à petit, on enregistre, on se sent légitime, on fait des concerts… » Kaozed, qui habite à Sommières, petite ville de l’autre côté du Vidourle qui sépare l’Hérault du Gard, se rappelle quand, arrivé au lycée, Bonobo et Kod.a.ma l’invitent à la caravane : « C’était ouf. Je me suis dit, “allions les forces, tout est possible !” – Même si notre rap sonnait et sonne toujours très urbain car beaucoup se sont installés en ville à l’âge adulte », nuance Bonobo, dont l’univers musical respire le bitume et les ruelles anciennes de Montpellier. Kaozed, lui, a fait le choix de rester et d’assumer son identité rurale. Si les inspirations musicales sont variées, new-yorkaises ou parisiennes, pareil à leurs titres, ses morceaux sentent la « Brousse » et on se perd dans le « No man’s land » : « Avec le temps, j’ai de plus en plus assumé d’où je venais, c’est une fierté. » Et rajoute : « La campagne, c’est inspirant. Les ambiances, les odeurs, les gens, y’a une richesse dans les noms de bled éclatés ! ». C’est clair qu’à regarder dans le coin : Congénies, Entre-vignes ou Sussargues, ça force l’inspiration !
Dans ses clips, on voit la « Bourgade » où « sur la place y’a même pas de gens/et dans les abribus y’a même pas de bancs », et les « Sentiers » qu’il traverse en mobylette « parce qu’on est quand même un peu beauf ! » Il taffe à la radio locale et a depuis constitué un collectif de hip-hop, « Deep Tieks », avec ses potes de toujours : « J’ai eu la chance de continuer avec eux. On a monté un studio, organisé un festival de hip-hop à Sommières. J’ai pensé plusieurs fois tenter ma chance ailleurs mais j’ai préféré faire les choses ici, c’était plus moi ». Et dynamiser le coin par le rap, le décentraliser ?
Julian, un ami rappeur d’une bande voisine, a fondé avec ses amis proches un groupe de « Reggae rap du Sud » : Riddim Flagada. « On représente les gens qui vivent ici. On retranscrit l’ambiance des villages du Sud, les paysages, on revalorise nos traditions et identités régionales mises en danger par la “culture française” uniformisante et imposée historiquement par l’État. » Julian dit s’inspirer des troubadours qui, entre le XIIe et le XIVe siècle, récitaient des poèmes et des chansons en langue d’oc à travers l’Occitanie. Ses titres : « Au cabanon », « Local » ou « Les filles du Midi ».
« Ça nous traversait pas l’esprit de rapper, sûrement par manque de légitimité et de figures rappeuses auxquelles s’identifier »
Les filles justement, où sont-elles dans ces groupes de rappeurs ? C’est Souf, une amie de la bande qui en parle : « Ça nous traversait pas l’esprit de rapper, sûrement par manque de légitimité et de figures de rappeuses auxquelles s’identifier. Même si j’aimais les soutenir, on se faisait chier à mourir à les regarder rapper dans le froid. Ça explique aussi pourquoi j’ai quitté le village . » Elle raconte, non sans fierté, une soirée où, quelques années plus tard « on a pris le mic et on a rappé pendant une heure avec les meufs en disant des conneries. C’était notre vengeance ! »
À Lunel (Hérault), la ville moyenne du coin, pas franchement riche, Julian raconte qu’un ami a monté un autre studio : « Tous les petits du coin viennent rapper ! Des villages ou bien des petites cités de Lunel. Le planning est toujours plein ! » Pour lui, « ils copient encore pas mal ce qu’ils écoutent. Par contre y’a plein de meufs ! Elles rappent énervées à la Keny Arkana ! » En dix ans, le nombre de rappeuses connues a explosé, de quoi donner aux jeunes femmes de la légitimité dans le game. Au-delà du genre, certains mecs ont pu, grâce au rap, connecter les champs et la cité : « Y’a des gens du 94 qui descendent de temps en temps dans mon bled pour qu’on rappe ensemble. On se marre, ils ont la culture de la vanne comme nous », résume Kaozed, dont le collectif a déjà invité la Scred Connexion, un crew de rappeurs parisiens, à venir poser à Sommières. Bonobo se rappelle les connexions qu’ils avaient nouées avec une équipe de rappeurs des cités de Perpignan : « On s’est entendu direct, grâce au rap évidemment. Mais aussi car on partageait les mêmes constats politiques. Ils nous ont aussi permis de mieux comprendre les difficultés de la banlieue. »
Reste à aller voir un peu plus loin encore où se cachent les autres rappeurs et rappeuses des champs et des ronds-points, des abribus et des bleds aux noms claqués. Dans un reportage pour France 3 diffusé en 2021, intitulé « Terres de rap », le réalisateur David Ctiborsky est allé plus à l’Ouest où, vers Toulouse, il a rencontré des bandes drôlement similaires. Ils rappent pour « les collines et les briques », connaissent aussi « l’éloignement, l’enclave et le rejet social » et disent partager « beaucoup de choses avec les rappeurs [urbains] même si le décor n’est pas le même ». Le rap a-t-il réussi ce que les politiciens de gauche ne sont jamais parvenus à faire, réunir le béton et les champs, les blancs et pas blancs, les bourgs et les tours ?
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°240 (avril 2025)
Dans ce numéro, un grand dossier « ruralité ». Avec des sociologues et des reportages, on analyse le regard porté sur les habitants des campagnes. Et on se demande : quelles sont leurs galères et leurs aspirations spécifiques, forcément très diverses ? Et puis, comment faire vivre l’idée de gauche en milieu rural ? Hors dossier, on tient le piquet de grève chez un sous-traitant d’Audi en Belgique, avant de se questionner sur la guerre en Ukraine et de plonger dans l’histoire (et l’héritage) du féminisme yougoslave.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°240 (avril 2025)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Anto Metzger
Mis en ligne le 28.04.2025
Dans CQFD n°240 (avril 2025)
Derniers articles de Étienne Jallot