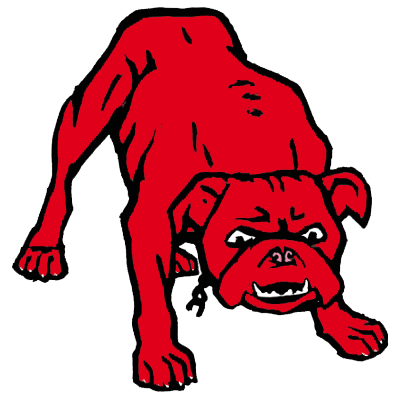Féminisme balkanique
La mémoire yougoslave ou l’art de lutter
Le 8 mars dernier, sous un soleil printanier, quelques centaines de personnes, toutes générations confondues, ont battu le pavé de Sarajevo à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À partir de 16 heures, elles étaient rassemblées devant la maison des syndicats, armées de drapeaux arc-en-ciel, de pancartes revendicatrices et de sifflets pour faire un maximum de boucan. Cette année, les mots d’ordre se concentrent sur les inégalités et le sexisme au travail : « Réduire l’ego, augmenter le salaire », « Barbie est sous-payée », « Je ne veux pas de rose, je veux de meilleures conditions de travail », pouvait-on lire ici et là. Concernant les questions de genre, sur le continent européen, la Bosnie-Herzégovine, comme beaucoup de ses voisins, fait figure de mauvaise élève1. Aussi, les féministes réhabilitent l’héritage de leurs aînées yougoslave.
La Bosnie-Herzégovine, comme beaucoup de pays du continent, possède tout l’arsenal législatif censé garantir l’égalité de genre dans le monde du travail. Sauf que son application est quasi inexistante. En 2019, les femmes constituaient ainsi près de 57 % des chômeurs du pays et 37,5 % des employées déclaraient avoir subi du harcèlement sexuel au travail2. Pour Andreja Dugandžić, militante membre de Crvena Sarajevo (Sarajevo Rouge)3, mettre la question du travail au centre de ce 8 mars 2025 était une évidence : « Il faut rappeler que la première fois que cette journée a été organisée, c’était justement pour l’amélioration du droit des femmes au travail. » Et si cela apparaît au premier plan cette année, c’est aussi grâce à l’implication de syndicats dans l’organisation. Une victoire selon Hana Ćurak, chercheuse dans le secteur culturel à l’Humboldt University de Berlin et fondatrice de la plateforme de production féministe Sve su to Vještice (Toutes des sorcières) : « C’est bien que l’initiative vienne aussi des syndicats ! Ici, c’est vraiment difficile de les mobiliser, car il y a beaucoup de confusion politique. »
« En Yougoslavie, le droit à l’avortement était dans la Constitution à partir de 1974 ! »
Au-delà du monde du travail, les Bosniennes font face à d’autres formes de violences. Selon Andreja Dugandžić, bien que l’avortement soit légal, il est de moins en moins pratiqué : « La religion est partout en Bosnie et le discours se concentre sur la famille et le contrôle du corps des femmes. Il n’y a pas assez de docteurs pour pratiquer l’avortement et certains refusent de le faire. » Pourtant, Andreja le rappelle : « En Yougoslavie, le droit à l’avortement était dans la Constitution à partir de 1974 ! »
Alors qu’on arrive devant le centre commercial de Sarajevo City Center sur la fin de Maršala Tita (Maréchal Tito), le boulevard principal de la ville, de nombreux automobilistes klaxonnent en soutien. Des militantes tentent de faire monter les décibels en haranguant chaque conducteur. Pendant ce temps, la banderole de tête, au style clairement inspiré du réalisme socialiste, fend l’air. On y voit quatre femmes de profile dont l’une porte un drapeau rouge.
Rien de surprenant tant les mouvements féministes des anciennes Républiques yougoslaves s’inspirent de l’héritage laissé par les Partisanes, ces combattantes antifascistes ayant participé à la libération de la Yougoslavie du joug nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Fondé en 1942, le Front antifasciste des femmes (AFŽ) mobilise les femmes dans la lutte pour la libération de la Yougoslavie. En tout, on estime que 110 000 femmes étaient membres d’unités militaires. « Plus ou moins 10 000 femmes ont participé à la lutte armée, raconte Andreja Dugandžić. Les autres étaient à l’arrière en tant qu’infirmières, à la production, à la distribution de nourriture... » Après la guerre, l’AFŽ participe à la réorganisation de la vie en Yougoslavie en se rapprochant du mouvement ouvrier. Petit à petit, « elles ont été transformées en forces techniques. L’AFŽ a appris à lire et écrire à plus de 400 000 personnes ! » En 1953, l’AFŽ cède à la pression de l’État et est démantelée sous prétexte « qu’il ne devrait pas y avoir d’organisation indépendante, puisque les droits des femmes sont censés être intégrés dans les affaires de l’État. » explique Andreja.
Aujourd’hui, le mouvement féministe bosnien réhabilite cette mémoire. Crvena Sarajevo a ainsi mené un travail sur la numérisation des archives de l’AFŽ4. Ce travail a pour but de remettre au goût du jour cette histoire « qui a toujours été, et reste relégué aux marges », pour « penser publiquement et de manière critique notre propre passé ». Pour Andreja, cela vient ainsi combler un manque : « Quand on a commencé à bosser sur les archives, il n’y avait que très peu de discussions autour de cette mémoire historiographique, même dans les milieux universitaires. » Surtout que la mémoire yougoslave a tendance à être occultée par les autorités nationalistes du pays, qui promeuvent des discours identitaires : « Il y a un projet de dépossession de l’héritage yougoslave. C’est vraiment important de riposter, d’être conscient de cette histoire et de la chérir afin d’agir pour le futur que l’on souhaite pour nous-même » complète Hana Ćurak.
Après le démantèlement de l’AFŽ en 1953, un mouvement féministe yougoslave se constitue dans les années 1970-1980 autour notamment de pratiques artistiques. En 1978, deux universitaires féministes, Nada Ler Sofronić et Žarana Papić en collaboration avec l’historienne de l’art, commissaire d’exposition et critique Dunja Blažević, organisent un cycle de conférences intitulé « Drug-ca žena : žensko pitanje – novi pristup ? » (« Camarade femme : la question des femmes – une nouvelle approche ? »), au Centre culturel étudiant de Belgrade (SKC). Cet événement est encore aujourd’hui considéré comme un tournant : pour la première fois, des féministes de l’Ouest et de l’Est se rencontrent et relient la question de l’émancipation à la fin du capitalisme à l’Ouest. Elles développent également une critique du patriarcat persistant au sein de l’État yougoslave qu’elles considèrent comme un « vestige bourgeois qui entre en contradiction avec ses principes [socialistes] »5.
« Je pense que nous sommes de plus en plus unis, au fur et à mesure que le monde part en vrille, et je trouve ça magnifique »
Aujourd’hui, le mouvement féministe bosnien est toujours lié à des pratiques artistiques mais pour des raisons plus pragmatiques. « Au début des années 2000, il y a eu beaucoup d’investissements dans l’art visuel en Bosnie de la part d’organisations internationales. » explique Hana Ćurak. Il était donc plus simple d’utiliser l’art pour gagner en visibilité, financer des activités et développer des discours féministes. Ces derniers temps, même ces financements se font rares. Mais cela n’empêche pas le cortège de terminer sa course festive au musée d’histoire de Bosnie-Herzégovine sous un superbe couché de soleil qui accueille prises de paroles, groupes de chants, DJ set et concert de rap. Hana Ćurak est pleine d’espoir : « Je pense que nous sommes de plus en plus unis, au fur et à mesure que le monde part en vrille, et je trouve ça magnifique ». Andreja Dugandžić aussi. Face à la montée du fascisme, elle lance : « Je veux qu’ils aient peur du mouvement féministe. Je veux qu’on soit effrayantes ! »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 « Table 5 : Gender Inequality Index », Human Development Report, United Nations Development Programme.
2 « Country Gender Equality Profile of Bosnia and Herzegovina », UN Women, 2021.
3 Sarajevo Rouge est une organisation féministe se concentrant sur la recherche, les pratiques artistiques, politiques et éducationnelles.
4 Lire « La dot féministe de Dunja Blažević », AWARE (09/09/2022).
5 Andreja Dugandžić et Tijana Okić, « The Lost Revolution – Women’s Antifascist Front between myth and forgetting », crvena.ba, 2018. On peut en lire une recension en français ici.
Cet article a été publié dans
CQFD n°240 (avril 2025)
Dans ce numéro, un grand dossier « ruralité ». Avec des sociologues et des reportages, on analyse le regard porté sur les habitants des campagnes. Et on se demande : quelles sont leurs galères et leurs aspirations spécifiques, forcément très diverses ? Et puis, comment faire vivre l’idée de gauche en milieu rural ? Hors dossier, on tient le piquet de grève chez un sous-traitant d’Audi en Belgique, avant de se questionner sur la guerre en Ukraine et de plonger dans l’histoire (et l’héritage) du féminisme yougoslave.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°240 (avril 2025)
Par
Illustré par Eloïse Pardonnet
Mis en ligne le 28.04.2025
Dans CQFD n°240 (avril 2025)
Derniers articles de Eliott Dognon