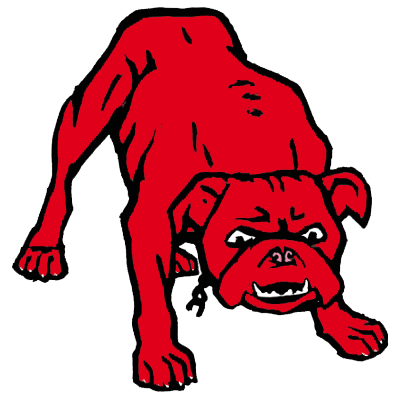L’ardoise salée de l’austérité
« Rembourser la dette comme on fait pénitence »
Récemment, le Premier ministre et son gouvernement démissionnaire ont tenu des propos alarmistes sur la dette de la France. Selon vous, la situation est-elle aussi grave qu’ils le disent ?
« Non, elle est loin d’être aussi catastrophique. D’abord, rappelons qu’une dette publique n’est pas comparable à une dette privée – celle des ménages ou des entreprises. L’État a ce qu’on appelle un “horizon infini”. Les ménages et les entreprises doivent solder leurs créances parce qu’ils peuvent mourir. L’État, lui, ne meurt jamais, et peut donc indéfiniment se refinancer en réempruntant : on dit qu’il “fait rouler la dette”. En revanche, il doit s’acquitter des intérêts : il s’agit de la fameuse “charge de la dette”.
Pour comprendre, il faut toujours raisonner en ratio de PIB : c’est le poids de la dette par rapport à la richesse nationale qui compte. En France, celui-ci se situe aujourd’hui autour de 113–115 % du PIB. Le chiffre peut impressionner parce qu’il dépasse 100 %, mais il doit être mis en perspective : certains pays développés sont nettement plus endettés (le Japon dépasse 200 %, les États-Unis sont à 124 %) et, historiquement, les ratios ont déjà été bien plus élevés, notamment pendant les guerres mondiales. Quant à la charge de la dette, c’est-à-dire les intérêts versés chaque année aux créanciers, elle représente environ 2 % du PIB. C’est relativement faible par rapport aux années 1990 et 2000 par exemple.
Pour évaluer la trajectoire de la dette, sa “soutenabilité”, les économistes observent l’écart entre le taux d’intérêt auquel le pays emprunte et son taux de croissance. Si le premier dépasse la second, cela signifie que la dette augmente plus vite que la richesse nationale, ce qui peut poser problème. Aujourd’hui, la croissance française est faible (autour de 0,4–0,5 %), tandis que les taux auxquels elle emprunte sont un peu au-dessus de 3 %. La dette risque donc de progresser plus vite que le PIB. Mais à mon avis, le cœur du sujet est surtout le manque de croissance : c’est l’insuffisance d’activité et de création de richesse qui pose problème. »
Raison pour laquelle la note de la France a été baissée par l’agence de notation Fitch ?
« Oui et pour autant, les taux d’intérêt ne sont pas montés en flèche. En réalité, notre dette est toujours considérée comme un actif sûr. Un signe révélateur est la stabilité des porteurs : une part croissante des investisseurs conserve les titres de dette française sur la durée, au lieu de les céder rapidement sur les marchés secondaires pour spéculer. Cette rétention de long terme constitue, en finance, un marqueur clair de confiance.
« Nous sommes tous, collectivement, propriétaires d’environ un quart de notre propre dette »
Un autre aspect souvent négligé concerne la répartition des détenteurs. Environ 45 % des titres sont aujourd’hui entre les mains de résidents et 55 % de non-résidents, un niveau parmi les plus élevés des pays développés. Cela traduit l’attractivité de la dette française, que fonds de pension, banques et assureurs achètent volontiers. À noter enfin : près d’un quart de l’encourt est détenu par la Banque de France, c’est-à-dire par une institution publique. Nous sommes donc tous, collectivement, propriétaires d’environ un quart de notre propre dette ! »
Dans une tribune signée dans Le Monde, vous pointez le récit « moral » entourant la dette. Qu’entendez-vous par là ?
« Tout à fait. C’est un discours qu’a fortement incarné François Bayrou récemment : la dette serait une “malédiction” collective. Cette représentation s’inscrit dans un héritage religieux et moral bien particulier, forgé dès les XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la tradition biblique, le même mot sert souvent à désigner la “dette” et la “faute” – en grec, en araméen, en hébreu. Et cette vieille équivalence imprègne encore nos imaginaires : la dette serait un péché à expier, qu’il faudrait rembourser comme on fait pénitence. Les efforts demandés prennent alors la forme d’une repentance collective. Il faut déconstruire ce mythe de toute urgence !
« Les cures d’austérité sont un remède pire que le mal, la BCE le sait et a changé d’attitude depuis la Grèce »
Dans nos économies capitalistes, la dette publique constitue un débouché pour les gros patrimoines. Elle n’est pas une faveur généreusement accordée par des prêteurs charitables à des États impécunieux, mais un placement pour des épargnants aisés en quête de rendement. Et du point de vue de l’État, il s’agit d’un instrument de financement parmi d’autres ! Ailleurs, dans certaines cultures africaines par exemple, la dette est dédramatisée : loin d’être perçue comme une faute, elle est une simple méthode de répartition. »
Le registre moral ne sert-il pas surtout à fabriquer du consentement à l’austérité ?
« Oui, c’est avant tout politique. En réalité, les finances publiques disposent de leviers pour alléger ou étaler la dette : renégociations, allongement des maturités, interventions des banques centrales, etc. Et si, par hypothèse, les taux s’envolaient et qu’une véritable crise survenait, la Banque centrale européenne (BCE) interviendrait. L’épisode grec l’a montré : les cures d’austérité sont un remède pire que le mal, elles compriment fortement la croissance et font mécaniquement augmenter le ratio dette/PIB. La BCE le sait, et a changé d’attitude depuis. D’autant que la France est l’un des pays moteurs de la zone et que l’euro est une monnaie solide : l’Eurosystème ne laisserait pas une telle déstabilisation mettre en péril l’ensemble.
Par ailleurs, l’austérité n’est pas seulement dangereuse d’un point de vue financier. Elle l’est aussi pour l’investissement dans des secteurs clés comme la transition écologique. Or, ce qui se creuse de manière inexorable, c’est bien la dette écologique ! Le voilà le vrai passif. Aucun tour de passe-passe comptable ni sauvetage institutionnel ne pourra l’effacer. »
À gauche, une contre-proposition aux économies prévues par Bayrou pour sortir la France de la banqueroute a émergé : l’emblématique « taxe Zucman ». Qu’en pensez-vous ?
« De nombreux travaux en économie ont montré que l’impôt est progressif jusqu’à un certain seuil au-delà duquel il se met à régresser. Ainsi, les 0,0008 % les plus fortunés s’acquittent d’environ 26 % d’impôts, tandis les 0,1 % les plus riches paient autour de 46 %. L’économiste Gabriel Zucman propose d’instaurer un plancher d’imposition de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches au-delà de 100 millions d’euros. D’après ses calculs, cela rapporterait près de 20 milliards d’euros. Ce n’est pas les 44 milliards que cherchait Bayrou, mais c’est déjà ça.
« Les aides publiques en faveur des entreprises sont un véritable capharnaüm : la France a empilé les mesures et Bercy peine à en dresser un inventaire exhaustif »
Toutefois, plusieurs juristes estiment que le Conseil constitutionnel pourrait censurer une telle mesure au nom du caractère potentiellement “confiscatoire” de l’assiette (environ 1 800 personnes). En 2012, il avait déjà retoqué des éléments de l’ISF pour un motif similaire1.
Quoiqu’il en soit, je comprends pourquoi la gauche érige cette mesure en totem : elle vise à changer de cap et à trouver des ressources ailleurs que dans la poche des plus précaires. Mais au-delà des modalités de financement de la dépense publique, il faut aussi de toute urgence examiner les effets de cette dépense. Et là, c’est tout le logiciel de l’État qu’il faut revoir ! Les aides publiques en faveur des entreprises par exemple : ces dispositifs sont devenus un véritable capharnaüm… Une commission d’enquête du Sénat a récemment avancé le fameux chiffre de 211 milliards d’aides (sans compter celles des collectivités). Depuis les années 1980, la France a empilé les mesures et Bercy peine à en dresser un inventaire exhaustif. Les évaluations montrent des effets quasi nuls sur l’emploi et la croissance ; l’impact principal tenant surtout en une reconstitution des marges. D’où une piste évidente : cartographier et simplifier ces dispositifs, puis les orienter dans une logique de planification en définissant, à 20 ou 30 ans, les filières et secteurs à soutenir. La planification écologique, les services publics, les secteurs stratégiques…Il y a beaucoup de chantiers ! »
À lire aussi :
>>> Nicolas Framont : « Les parasites ne sont pas ceux que l’on croit »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 À part ces éléments précis, l’ISF touchait plusieurs centaines de milliers de ménages qui, chaque année, devait s’acquitter d’un impôt direct calculé sur la valeur du patrimoine, avec un barème progressif dès 1,3 million d’euros. Loin d’être un « matraquage fiscale », la mesure avait quand même un certain panache. La taxe Zucman, elle, ne vise que les immenses patrimoines et est surtout corrective : on fixe un minimum d’impôt de 2 % puis, chaque année, on regarde ce que la personne a déjà payés et si c’est inférieur à 2 % de sa fortune, on lui demande de compléter. Elle est donc beaucoup moins transformatrice pour l’ensemble du système fiscal.
Cet article a été publié dans
CQFD n°245 (octobre 2025)
Ce numéro d’octobre revient, dans un grand dossier spécial, sur le mouvement Bloquons tout et les différentes mobilisations du mois de septembre. Reportages dans les manifestations, sur les piquets de grève, et analyses des moyens d’actions. Le sociologue Nicolas Framont et l’homme politique Olivier Besancenot nous livrent également leur vision de la lutte. Hors dossier, on débunk le discours autour de la dette française, on rencontre les soignant•es en grève de la prison des Baumettes et une journaliste-chômeuse nous raconte les dernières inventions pétées de France Travail.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°245 (octobre 2025)
Par
Illustré par JMB
Mis en ligne le 11.10.2025
Dans CQFD n°245 (octobre 2025)
Derniers articles de Gaëlle Desnos