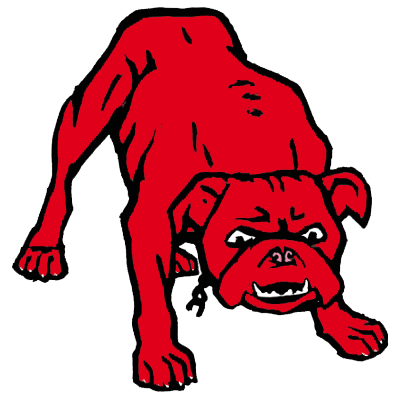Vins libertaires et bières sociales
Du terroir au mouroir
Dans le sud de l’Aude, sur les coteaux des Hautes-Corbières, la terre est argilo-calcaire. C’est ici qu’Hervé a racheté quatre parcelles de vieilles vignes délaissées par les viticulteurs car aucun tracteur viticole ne peut frayer entre les rangs serrés des ceps.
Hervé travaille à la main : il ébourgeonne ses vignes à l’ancienne, les taille pour leur donner une belle forme. Quand vient l’heure des vendanges, il fait appel aux amis. Si partout ailleurs la cueillette du raisin rime avec rentabilité, ici l’affaire à plus à voir avec la convivialité. À une époque, l’homme fut tenté de faire de la viticulture sa profession mais voilà, le contexte économique a vite douché ses ardeurs. « J’ai été coopérateur à la cave de Paziols. Je faisais du bon vin, j’en donnais aux copains. Et puis la cave a fusionné avec celle de Mont-Tauch, du village de Tuchan… » Et la machine s’est emballée. Pour continuer à toucher les aides européennes, Mont-Tauch a absorbé d’autres coopératives et modernisé ses infrastructures. Les coopérateurs ont laissé un comité d’administration composé de « spécialistes » piloter le nouveau montage, tandis qu’une équipe de commerciaux a démarché les supermarchés, n’hésitant pas à proposer un catalogue fourre-tout, du champagne au Banyuls en passant par le muscat. « De 2000 à 2010, les vignerons ont touché de gros acomptes. Ils ont changé leur équipement, roulé en 4x4. Puis le délire mégalomane s’est cassé la gueule », résume Hervé. Malversations, folie des grandeurs, la cave de Mont-Tauch se retrouve avec une ardoise de 20 millions d’euros et une liquidation judiciaire sur le râble. Le 11 avril dernier, 400 manifestants exigeaient du Crédit agricole une remise de dette.

« La mondialisation a détruit la coopération », résume Jean Lhéritier, président de l’association Slow-Food France. Pour rester compétitives, les caves coopératives se sont concentrées. Paradoxe : les coopérateurs ont mimé les industriels alors que leur statut, hérité de longues luttes, rendait rédhibitoire toute stratégie capitalistique. Partant d’une production de petit paysan, le modèle viticole français se voit laminé par les wineries, gros complexes industriels faisant florès en terre anglo-saxonne et dont la production sature le marché. Et les goûts. « La réalité des vins produits en France est complexe : il faut connaître les noms de région, de sous-régions et des cépages. Un vin s’affiche par le nom de domaine et d’appellation. Sur des grands marchés de pays non connaisseurs, il est ardu de savoir ce que veut dire “Domaine des Schistes, côtes de roussillon village”, par exemple. Pourquoi ? Parce que le vin industriel affiche le nom du cépage. Par exemple, les chardonnays d’Australie ou les pinots noirs d’Afrique du Sud. » Une logique de bulldozer qui vient flinguer le travail de précision des appellations d’origine contrôlées (AOC) pour lesquelles, au-delà du cépage, tout est question de terroir. Rappelons que l’AOC, malgré son clinquant, est tout sauf un logo commercial. Il garantit le savoir-faire d’une zone géographique délimitée. Pas étonnant donc que les penseurs du grand traité transatlantique y aient vu un insupportable bourgeon du protectionnisme français. Tandis que le pinard industriel est prêt à envahir nos godets, petits producteurs comme grands domaines prestigieux (voir le château Palmer et ses boutanches frôlant les 150 euros l’unité) négocient le virage vers les vins propres et respectueux au gré d’une tendance sociétale qui s’affirme.
Dans le sillage de ce business où le pinard français devient avant tout affaire de devises (5,6 milliards d’euros d’exportations en 2012), la terre, elle, s’appauvrit. « Beaucoup de vignerons cherchent à vendre leur terre qui vaut trois à quatre fois moins cher qu’il y a trois ans. Tout autour, on voit des vignes abandonnées, arrachées, dévitalisées, constate Hervé avec pessimisme. La viticulture devient synonyme de survie. »
La suite du dossier
« Le vin nature est une goutte de vin dans un océan de produits œnotechniques »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°122 (mai 2014)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°122 (mai 2014)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Felder
Mis en ligne le 10.07.2014
Articles qui pourraient vous intéresser
Dans CQFD n°122 (mai 2014)
Derniers articles de Sébastien Navarro