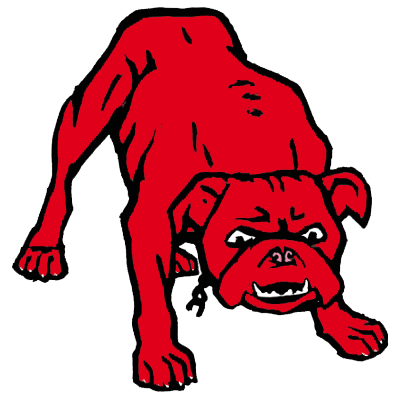Quitter le mode sexiste et colonial
Collectif Afrogrameuses : « Certains hommes blancs considèrent encore le jeu vidéo comme leur chasse gardée »
Dans le monde, 48 % des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses, et même des utilisatrices régulières, c’est-à-dire plus d’une fois par semaine, voire quotidiennes pour 56 % des 16-30 ans. Quant au public non blanc, il semble qu’il soit tout aussi présent dans la communauté. Alors pourquoi ce tenace sentiment que le jeu vidéo, son industrie et son écosystème, demeure la chasse gardée de quelques hommes blancs ? Parce que tous les autres ont été et sont encore invisibilisés, tranche Jennifer Lufau. Cette consultante accompagne la création d’univers immersifs et authentiques, et milite au sein de l’association Afrogameuses pour la visibilité des joueurs et joueuses non blancs sur la scène vidéoludique. Elle nous a expliqué comment le jeu vidéo a été colonisé par des stéréotypes raciaux et sexistes, mais aussi comment, depuis les marges, la résistance s’organise...
Quelle part représente les minorités au sein de l’industrie des jeux vidéo ? Comment y sont-elles accueillies ?
« L’idée selon laquelle le jeu vidéo est avant tout masculin et blanc s’est solidement ancrée »
« Au niveau de la parité, les femmes ne représentent que 24 % des professionnels du secteur et les personnes non binaires 5 %. Sur le plan ethnique, la France ne fait pas ce genre de statistiques, donc on ne peut s’en tenir qu’aux perceptions. Mais depuis mon expérience, je peux dire que l’industrie française du jeu vidéo reste peu diverse. J’y suis entrée via Ubisoft, en pleine vague d’accusations de discrimination et de harcèlement sexuel [lire « Un empire nommé Ubi » page 8]. C’était un peu anxiogène mais j’avais besoin de travailler et ce studio est une case à cocher dans le milieu. Heureusement, je n’ai pas été victime de harcèlement. Mais j’ai vite compris que j’étais une des seules personnes non blanches de la boîte et qu’il faudrait que je fasse mes preuves plus que quiconque. Au début, on me prenait pour une stagiaire, je devais tout le temps préciser que j’étais en CDI. Je faisais partie d’un groupe travaillant à améliorer la représentation des personnes noires en interne et avec mon engagement militant en dehors, on me sollicitait beaucoup sur ces questions. Mais j’ai peu à peu eu le sentiment d’être utilisée comme un token1. Si je ne mettais pas des limites, ces demandes empiétaient sur mon temps de travail. En fin de compte j’ai constaté que j’étais moins payée que des collègues arrivés après moi, avec moins d’expérience, dans la même équipe. C’était clairement le signal que je n’évoluerais pas chez Ubisoft et je suis partie. »
Quels sont les freins principaux à l’inclusivité dans cette industrie ? Pourquoi semblent-ils autant persister ?
« Pour comprendre, il faut remonter au début des années 1980. À l’époque plusieurs études documentent une forte représentation des hommes parmi les joueurs de jeux vidéo. Nintendo décide alors d’ajuster sa stratégie et lance une nouvelle console, la NES, marketée pour les jeunes garçons blancs des banlieues pavillonnaires américaines. Le succès est immédiat. Dans la foulée, la marque sort l’un de ses produits les plus emblématiques : la Game Boy. Un nom qui ne laisse plus aucun doute sur son cœur de cible ! Ensuite, l’industrie va peu à peu se mettre à concevoir des jeux à l’aune de ce qu’elle suppose être les attentes du consommateur type : combat, sport, armes, voitures…
« Il m’a fallu dix ans de gaming avant de jouer un personnage de femme noire pour la première fois »
Aujourd’hui, on sait qu’il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses dans le monde. Et les personnes non blanches sont aussi très nombreuses ! Mais l’idée selon laquelle le jeu vidéo est avant tout masculin et blanc s’est solidement ancrée. Ça s’accompagne d’un fort gatekeeping [littéralement « garder la porte », autrement dit le fait de contrôler l’accès à un espace, une communauté, une activité ou un savoir, de manière arbitraire ou discriminatoire, ndlr] de la part d’hommes qui considèrent encore le jeu vidéo comme leur chasse gardée. Certaines pratiques sont même dépréciées : quand tu ne joues pas à des FPS [« First-Person Shooter », un genre de jeu vidéo où l’on voit l’action à travers les yeux du personnage, souvent avec une arme visible au bas de l’écran, ndlr], à des jeux de guerre ou très difficiles, on ne considère pas que tu es un gamer [un joueur, ndlr]. L’industrie de la création vidéoludique a donc quasiment été configurée par et pour des hommes blancs. Difficile, quand on est une femme, non blanc ou quand on a des pratiques de jeu différentes, de se faire une place. »
Cela va aussi avoir un impact au sein des jeux avec un déficit de personnages principaux femmes ou non blancs…
« Aujourd’hui, les personnages de femmes ou non blancs sont plus présents qu’avant, mais on se contente trop souvent de puiser dans des clichés pour les concevoir »
« Dans les jeux, il y a longtemps eu toutes sortes de créatures imaginaires : des monstres, des robots, des elfes… Mais des avatars féminins noirs, c’était quasi inimaginable ! Pour ma part, il m’a fallu dix ans de gaming avant de jouer un personnage de femme noire pour la première fois. Je me souviens de l’impact immense que ça eu sur moi : je me suis rendue compte que j’avais le droit d’exister dans ce monde-là. Diamond Lobby, un site spécialisé dans le gaming, a enquêté sur 100 jeux majeurs sortis entre 2017 et 2021. Les résultats sont accablants : 80 % des protagonistes principaux sont des hommes, plus de la moitié sont blancs, le reste représentent toutes les autres origines, et 8 % seulement sont à la fois femmes et non blanches. On est vraiment loin du “grand remplacement wokiste” invoqué par les geeks mascu ! »
Comment les studios, majoritairement composés d’hommes blancs, peuvent-il créer des personnages racisés, féminins crédibles ?
« Effectivement, à partir du moment où les studios sont majoritairement masculins et blancs, la question se pose. Aujourd’hui, les personnages de femmes ou non blancs sont plus présents qu’avant, mais on se contente trop souvent de puiser dans des clichés pour les concevoir. Je pense notamment au tout dernier Tekken : Miary Zo, une combattante malgache, y est représentée en haut de bikini et mini-short moulant, avec des accessoires de style “tribal”. Cacao et Vanilla, deux petits lémuriens, l’animal emblématique de Madagascar, l’accompagnent. Une exotisation typique. Même l’excellent jeu Banishers : Ghosts of New Eden n’échappe pas à certains écueils : son unique personnage noir meurt dès le départ. Pourtant ce trope narratif raciste dans lequel le personnage noir meurt en premier dans les œuvres de fiction, le “Black Guy Dies First”, a été identifié depuis les années 1970-80 !
« La question ne résume pas à une affaire de quotas de personnages noirs ou féminins : il y a un véritable enjeu autour de la représentation du monde non occidental »
Est-ce que les studios doivent pour autant renoncer à créer ces personnages ? Je ne crois pas. Je suis convaincue qu’on peut tous raconter des histoires qui ne nous appartiennent pas. Il suffit d’avoir envie de le faire avec justesse, de s’entourer des bonnes personnes, de faire des recherches, de travailler les personnages, leur langue, leur culture… Et de ne pas le faire seulement pour éviter le bad buzz. »
Et au-delà des personnages, les univers, les codes visuels et les arcs narratifs sont aussi occidentalo-centrés…
« Tout à fait, la question ne résume pas à une affaire de quotas de personnages noirs ou féminins. Il y a un véritable enjeu autour de la représentation du monde non occidental. Celui-ci est peu représenté, et quand il l’est, c’est bien souvent à travers le prisme colonial. Parmi les exemples les plus marquants : Resident Evil 5. L’action se déroule en Afrique subsaharienne, dans une région fictive où une grande partie de la population est infectée par un virus qui la transforme en zombie. Le personnage principal est un enquêteur blanc chargé de nettoyer la zone et de sauver la population locale. Là, vraiment, on sent que personne n’a réfléchi au message !
Pour autant, l’afrofantasy, qui s’inspire des mythes, légendes, cosmogonies et cultures africaines pour créer des récits, est un genre qui commence peu à peu à émerger. Je peux notamment citer le jeu Tales of Kenzera : ZAU, sorti en 2024, dans lequel on incarne un jeune chaman confronté à la perte de son père. Il y a également Relooted, développé par la studio sud-africain Nyamakop, qui se rapproche des codes de l’afrofuturisme, un genre qui puise dans les cultures africaines et afrodiasporiques pour imaginer des futurs où les expériences noires façonnent le monde. Le joueur est plongé dans un futur proche et doit braquer des musées pour restituer des œuvres spoliées pendant la colonisation. Ces narrations, bien qu’encore minoritaires, fleurissent de plus en plus sur la scène vidéoludique ! »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Un « token » désigne une personne issue d’un groupe minoritaire incluse principalement pour donner l’impression de diversité plutôt que pour ses compétences réelles.
Cet article a été publié dans
CQFD n°244 (septembre 2025)
Pour cette rentrée agitée politiquement et socialement, on vous propose un dossier sous le signe de détente (pas tant que ça) : les jeux vidéos. Une industrie bien capitaliste reproduisant toujours les mêmes dominations. Mais certains·es irréductibles luttent pour déconstruire tout ça. Allez, à vos manettes ! Hors dossier, on analyse de la hausse des droits de douane, on prend des nouvelles (pas très bonnes) des indépendantistes Kanaks jugés devant les tribunaux, on donne la parole aux pompiers du Sud, en première ligne face au incendies et on s’intéresse aux violences policières en Belgique.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°244 (septembre 2025)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Garte
Mis en ligne le 06.09.2025
Dans CQFD n°244 (septembre 2025)
Derniers articles de Gaëlle Desnos