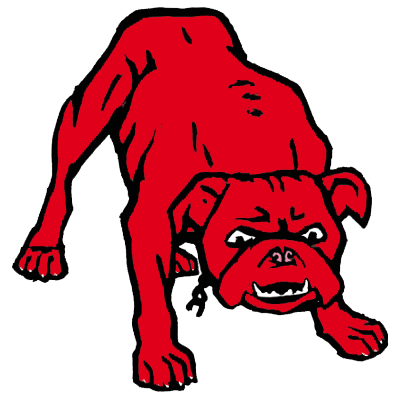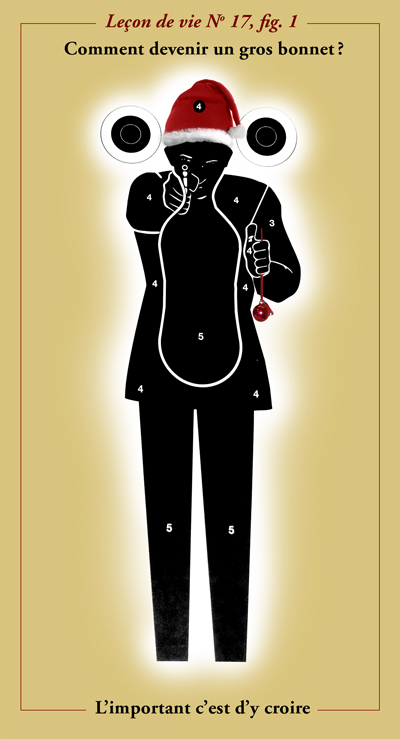« Les bibliothécaires sont perçus comme des envahisseurs »
2005-2015 : 10 ans après les émeutes en banlieues

CQFD : Les bibliothèques sont parfois la cible de violences dans les quartiers populaires. Pourquoi sont-elles aussi mal perçues ?
Charlotte Perrot-Dessaux : J’ai travaillé sur différents terrains, mais je retrouve à chaque fois les mêmes dynamiques. Pourquoi s’en prendre aux bibliothèques ? Je crois que la réponse vient de l’état lui-même, et de la culture qu’il souhaite dispenser dans les quartiers. Quels sont les objectifs des politiques publiques ? Que veut-on faire quand on construit une bibliothèque dans un quartier ? Dans les réponses apportées, on retrouve toujours le même discours : nous allons « améliorer et transformer le quartier », « créer du lien social », « favoriser la mixité sociale », mais aussi « modifier les pratiques des jeunes ». Leur objectif est clair : il s’agit de pacifier les rapports sociaux dans des territoires décrits comme violents, avec des problèmes de délinquance, de trafic, d’incivilités, mais aussi de « communautarisme ». Cela apparaît dans les textes, les discours des élus locaux et des bibliothécaires. Finalement, il y a une distance énorme entre l’institution et le quartier, et cela se traduit concrètement sur le terrain par une opposition entre les bibliothécaires et certains adolescents. Cette opposition est alimentée par la différence d’âge, d’origine et de lieu de résidence – souvent, les bibliothécaires n’habitent pas le quartier. Du coup, ils sont perçus comme des envahisseurs. Leur légitimité est questionnée en tant qu’adultes et en tant que professionnels.
Pourtant, les livres devraient être des outils d’émancipation ?
Dans le discours, les bibliothèques démocratisent l’accès à la culture et, théoriquement, les usagers en font ce qu’ils veulent. Ils doivent, selon les textes, s’approprier cet espace. Mais dans les faits, c’est différent : des normes sont imposées, très rigides. Interdiction de garder la casquette, ses écouteurs, interdit de se saluer en langue étrangère au sein de la bibliothèque. En théorie, l’accès à la bibliothèque est gratuit. Mais c’est faux, on le « paye » physiquement. Il y a un véritable travail de normalisation envers les conduites et les pratiques linguistiques de certains individus.
Les choix culturels portés au sein des bibliothèques ne jouent-ils pas aussi un rôle dans ces tensions ?
Effectivement, car on trouve encore des résistances dans le domaine des hiérarchies culturelles. Il existe deux positions : soit offrir aux gens la culture telle que définie depuis André Malraux, dans une perspective de démocratisation culturelle, soit offrir ce que le public attend, demande, dans le cadre d’une démocratie culturelle. Quand certains souhaitent lire le dernier Marc Levy, des bibliothécaires affirment que « ce n’est pas un livre, ce n’est pas de la culture ». Mais tous n’ont pas ce discours : si des gens aiment ça, pourquoi ne pas le mettre à disposition ? Dans les équipes que j’ai rencontrées, une partie provient du mouvement d’éducation populaire, et ces gens affirment être là pour « élever le niveau ». De fait, c’est surtout dans les nouvelles générations que l’on trouve des personnes légitimant tous les goûts. Dans la pratique, il faut ajouter à cela les nombreux conflits inhérents au fait que la relation à l’autre ne fait pas partie de la formation des bibliothécaires. Lesquels reprennent les représentations sur les « jeunes des cités ».
Cette hiérarchisation culturelle, les comportements de certains usagers et le fait que la bibliothèque soit perçue comme un outil de changement parachuté par les pouvoirs publics conduisent à des conflits diffus, quotidiens. Les violences contre les bibliothèques ne sont que la dimension spectaculaire de ce qui se distille le reste du temps. Au jour le jour, ce sont une multitude de petites différences, incompréhensions qui cristallisent une distance entre des groupes sociaux qui ne se reconnaissent pas.
La bibliothèque n’est-elle pas aussi perçue comme superflue par rapport aux difficultés pratiques des habitants de ces quartiers populaires ?
Des habitants pensent que c’est un projet qui vient d’en haut, qui n’a pas été pensé par eux. On ne leur a pas demandé s’ils avaient besoin de cela. Et, étant donné leurs conditions de vie, le chômage, la précarité, ils se demandent si la priorité était vraiment d’avoir une bibliothèque.
Les adolescents analysent-ils leurs rapports à la bibliothèque en termes de classes sociales ?
Les ados qui la fréquentent sont convertis à la valeur « lecture », et ils sont les premiers à dire qu’il est normal qu’il y ait des normes, même s’ils « foutent le bordel » et se font parfois exclure. Quant à ceux qui ne s’y rendent pas, ils expliquent que la bibliothèque est une institution de « Blancs ». Mais en discutant avec eux, on se rend compte que le mot « Blanc » désigne à la fois les « pouvoirs politiques », les « élites », les « intellectuels », les « bourgeois », voire les « Parisiens ». On trouve donc une imbrication des classes sociales, de l’ethnicité et des territoires. Il existe donc une lecture de classe, mais qui est plus large et plus complexe que cela.
Des bibliothèques ne cherchent-elle pas à embaucher des gens des quartiers populaires, et modifier leur image ?
Où je travaille, la direction est assez attentive à ce que les habitants aient leur place dans le recrutement. Mais elle est aussi très attentive à ce que cela ne soit pas le premier critère. Les bibliothécaires extérieurs au territoire restent majoritaires. Et quand ils sont embauchés, les habitants des quartiers ont souvent les grades les plus subordonnés, faute de niveaux de diplôme et de formation suffisants… Cela dit il faut souligner que de réels efforts sont faits pour désacraliser la bibliothèque et l’ouvrir au plus grand nombre, dans le cadre de la constitution des collections ou de l’action culturelle. L’introduction des jeux, des jeux vidéos, de multiples supports s’inscrivent dans cette dynamique d’ouverture. Toutefois, une certaine conception de la lecture et de la culture persiste, conduisant bien souvent à délégitimer les pratiques et goûts culturels de certains groupes sociaux, alors qu’un des enjeux premiers des bibliothèques publiques est de participer à la réduction des inégalités sociales.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°138 (décembre 2015)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°138 (décembre 2015)
Par
Illustré par Rémi
Mis en ligne le 03.03.2018
Articles qui pourraient vous intéresser
Dans CQFD n°138 (décembre 2015)
Derniers articles de Jean-Baptiste Legars
- <
- >