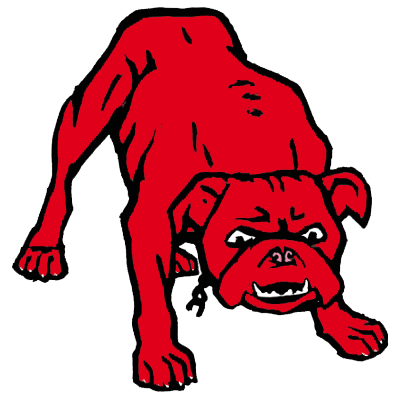1955 : La révolte des conscrits
Ils sont plus de six cents, ces réservistes de l’armée française qui, le 11 septembre 1955, sont rassemblés gare de Lyon à Paris, pour rejoindre le Maroc où la revendication d’indépendance connaît, depuis deux ans, une brusque accélération. Sur les quais, rares sont les bidasses qui ignorent que des négociations entre responsables marocains et français sont en cours depuis la fin août. En effet, l’État colonial, encombré par la situation marocaine – et dont il va se débarrasser en novembre en lui accordant l’indépendance –, a décidé de tourner ses forces contre le soulèvement algérien qui a débuté un an auparavant. Les troufions refusent de monter dans les trains. Ce sont des policiers et des gendarmes qui les contraignent à rejoindre leurs casernements en vue de leur prochain acheminement par avion vers le protectorat chérifien où la police militaire les attend avec gourmandise…
Dans ces heures sombres, nombreux sont les conscrits qui ne peuvent admettre d’avoir à faire subir à des populations ce qu’eux-mêmes et leurs familles ont connu une dizaine d’années plus tôt, pendant l’occupation allemande. D’autant que ceux-là, destinés à mener « des opérations de maintien de l’ordre et de pacification dans les zones rebelles » ont déjà effectué leurs obligations militaires. Ce sont des rappelés qui, après un retour à la vie civile, renquillent pour un temps dont la durée varie au gré des valses gouvernementales de la IVe République. Le 7 octobre, des milliers de Rouennais, dont un grand nombre de ces dockers qui avaient bloqué le chargement d’armes destinées à la guerre d’Indochine, soutiennent les bidasses du 406e régiment qui refusent de quitter la caserne Richepanse. Les gardes mobiles interviennent. Les affrontements dureront trois jours avant que le bâtiment militaire ne soit mis à sac. Les troufions seront embarqués en direction du camp de Sissonne sous la menace des armes de la garde mobile. Quelques jours plus tard, une centaine d’appelés bloquent les rues de Valence et s’en prennent à du matériel ferroviaire. Le 23, ils sont plusieurs centaines, revêtus de leurs uniformes, à manifester sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris. Ces mouvements – soutiens de la population, manifestations, distributions de tracts, refus d’obéissance – porteront dans un premier temps leurs fruits : ces soldats retrouveront leurs foyers avant la fin de l’année. L’engagement du Front républicain pour « la paix en Algérie », arrivé au pouvoir en janvier 1956 à l’occasion d’élections anticipées, ne tiendra pas trois mois. En mars, le gouvernement vote « les pouvoirs spéciaux » qui allongent la durée du service militaire, maintiennent sous les drapeaux les appelés et rappellent encore une fois les réservistes. Aussitôt, les protestations reprennent. Le 5 mai, des habitants de la Rochelle bloquent le départ des bidasses. Le 18, des centaines de personnes bloquent les voies de la gare de Grenoble. Les gardes mobiles qui tentent de les déloger sont attaqués par les manifestants dont le nombre grossit au fur et à mesure que les ouvriers sortent de leurs ateliers et usines. Une grue est renversée sur les voies et du béton coulé sur les aiguillages alors que l’émeute gagne les quartiers populaires. Dans de nombreux trains, appelés et rappelés tirent les systèmes d’alarmes. Des rumeurs rapportent qu’une révolte a éclaté le 28 mai dans le camp de la Fontaine du Berger à proximité de Clermont-Ferrand. Le 8 juillet, deux mille rappelés prennent le contrôle du camp de Mourmelon, s’emparent du général Zeller, futur chef de l’OAS, avant de le laisser filer à poil, affrètent des cars et regagnent tranquillement leurs foyers. Entre avril et juillet plus de trois cents incidents, blocages, manifestations, révoltes et mutineries seront ainsi recensés. Mais face à la répression, les actes de résistance vont lentement se déliter.
Rares sont ces bidasses qui conserveront outre-Méditerranée la mémoire de ces actes de refus. Quelques-uns rejoindront les rebelles, parfois avec des armes, d’autres préféreront déserter ou contribuer en France à la lutte des Algériens. Quant au plus grand nombre, après avoir été délibérément envoyés par leurs officiers dans des situations périlleuses, ils retrouveront vite les gestes de la pire soldatesque et ramèneront dans leurs valises fracassées, une puissante contribution à ce racisme anti-arabe qui continue d’empester l’air aujourd’hui…
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°96 (janvier 2012)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°96 (janvier 2012)
Dans la rubrique Les vieux dossiers
Par
Mis en ligne le 08.03.2012
Dans CQFD n°96 (janvier 2012)
Derniers articles de Gilles Lucas