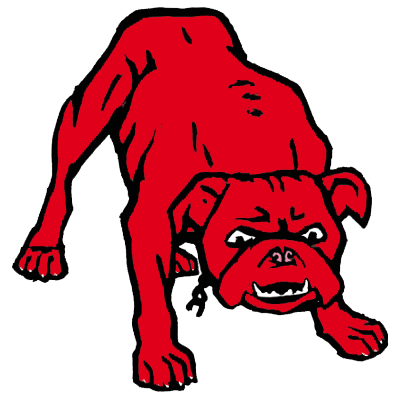Quoi de neuf dockers
Un mois de mobilisations internationales pour la Palestine
Le 4 juin dernier un cargo israélien à destination d’Haïfa arrive au port de Fos-sur-Mer. Il fait escale pour embarquer à son bord 19 palettes de pièces détachées de fusils mitrailleurs, des petits morceaux de métal permettant de tirer en rafales, tout droit sortis des usines de la société française Eurolinks1. Apprenant l’existence de cette mortelle cargaison, les travailleur·euses portuaires et leur syndicat la CGT, bien implantée à Fos, refusent de charger les 14 tonnes de marchandises. « Les dockers et portuaires du Golfe de Fos ne participeront pas au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien », fait savoir la CGT dans un communiqué. Le lendemain, réaffirmant leur solidarité avec le peuple palestinien, les dockers bloquent l’embarcation de deux nouveaux conteneurs remplis de tubes de canons fabriqués dans la Loire par la compagnie métallurgique Aubert et Duval.
Face à l’hypocrisie du gouvernement français, l’action des dockers apparaît comme exemplaire
Face à l’hypocrisie du gouvernement français, qui commence timidement à critiquer « l’extension des opérations militaires israéliennes à Gaza » tout en maintenant ses traités commerciaux, ses partenariats politiques et ses livraisons d’armes avec Israël, l’action des dockers apparaît comme exemplaire. Occupant une place stratégique dans le circuit mondial des flux de marchandises, ces travailleur·euses de la logistique ont montré qu’ils et elles ont la capacité de s’opposer concrètement et directement à l’acheminement d’armes vers l’État sioniste, très largement dépendant du soutien qu’il reçoit de ses alliés occidentaux, les États-Unis en tête. Organisé·es au sein du Collectif autonome des travailleurs portuaires (CALP)2, les travailleur·euses du port de Gênes ont suivi leurs camarades de Fos-sur-Mer dans leur blocage. Dans les mois précédents, d’autres actions similaires avaient déjà eu lieu à Gênes et à Marseille ou encore au Pirée, à Tanger et en Suède3. Seulement, en l’absence de coordination internationale entre les dockers, ce genre d’actions sporadiques et isolées ne peuvent réussir à désorganiser significativement les réseaux logistiques sur lesquels repose le massacre à Gaza.
Reste qu’elles insufflent un vent d’espoir bienvenu au sein du mouvement de solidarité avec la Palestine. Dans les jours qui suivent la grève, des « bravo les dockers » s’élèvent au-dessus des rassemblements propalestiniens en France. Chacun luttant depuis où il se situe, d’autres citoyen·nes, qui n’occupent pas une place décisive dans le système de production et de logistique, décident d’augmenter d’un cran la pression sur les gouvernements en tentant de se rendre directement à Gaza pour exiger la levée du blocus humanitaire, imposé début mars par Israël.
Chacun luttant depuis où il se situe, des citoyen·nes ont décidé d’augmenter d’un cran la pression en tentant de se rendre directement à Gaza pour exiger la levée du blocus humanitaire
C’est le cas de Rakia, contrôleuse de paie à Aix-en-Provence. Il est 2 heures du matin lorsque son avion atterrit sur le tarmac de l’aéroport du Caire le vendredi 13 juin. Elle réussit à passer le poste-frontière avec sa petite valise à roulettes sans être interceptée par la police égyptienne. Un coup de chance. Le lendemain matin, elle doit rejoindre des milliers de militant·es venu·es des quatre coins du globe pour participer à la « Global march to Gaza » (« La marche mondiale vers Gaza »). Une marche depuis la ville d’El-Arish, tout à l’est de l’Égypte, jusqu’à la frontière avec Rafah. 45 kilomètres à parcourir en près de trois jours. C’est du moins ce qui était prévu. Car dans les heures qui précèdent le départ, Rakia reçoit de nouvelles informations via la plateforme de communication Signal. Les chauffeurs de bus affrétés par les organisateur·ices ont été arrêté·es, les véhicules saisis, et un nouveau point de rendez-vous est fixé.
Chacun·e doit désormais se rendre par ses propres moyens à Ismaïlia, à une centaine de kilomètres du Caire. Des centaines de taxis s’élancent alors de la capitale vers le point de rassemblement. Enfoncée dans le siège arrière du taxi, baissant la tête à la vue des forces de police traquant les « marcheur·euses », Rakia passe un premier barrage. Quelques kilomètres plus loin, un nouveau check-point à l’entrée du dernier péage avant Ismaïlia. Cette fois, la police arrête son véhicule et saisit son passeport. Venue toute seule, Rakia se retrouve immobilisée sur un petit morceau d’autoroute égyptien avec un millier de personnes, unies par un besoin viscéral de crier leur refus du génocide à Gaza. « Il y avait des Français, des Sud-Africains, des Chiliens, près de 52 nationalités réunies. J’ai vu une grand-mère avec sa fille et sa petite-fille. Une dame en fauteuil roulant. J’en ai eu des frissons. J’ai ressenti tellement d’humanité là-bas, c’était magnifique », raconte-t-elle, émue, en montrant les vidéos sur son téléphone.
« L’idée était qu’entre mai et juin soient coordonnées plusieurs tentatives de rupture du blocus, à la fois terrestres et maritimes »
Durant tout l’après-midi, les organisateur·ices tentent de négocier le passage vers la frontière avec la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes restent inflexibles. « Il y avait des gens qui les suppliaient de nous laisser passer, mais nous avions des murs face à nous », relate Rakia, pleine de colère. En fin de journée, la police ordonne à tout le monde de quitter les lieux. Les coups pleuvent sur celles et ceux qui refusent de partir. Iels seront expulsé·es de force vers leur pays. « Honnêtement, j’espérais qu’Israël ouvrirait le blocus sous la pression populaire », reconnaît Rakia. Mais grâce au soutien zélé du pouvoir égyptien déployant tout son arsenal de surveillance et de répression pour empêcher la marche, Israël n’a même pas eu besoin de bouger le petit doigt. Au même moment, la caravane Soumoud (résilience ou persévérance en arabe), partie de Tunisie avec plus d’un millier de personnes était bloquée par les autorités libyennes. Quelques jours plus tôt, la flottille pour la liberté était arrêtée au large de Gaza.
« L’idée était qu’entre mai et juin soient coordonnées plusieurs tentatives de rupture du blocus, à la fois terrestres et maritimes », explique Baptiste André. Il est l’un des douze membres de l’équipage du Madleen, voilier parti des rives de la Sicile le 1er juin pour tenter d’apporter une aide humanitaire toute symbolique à la population gazaouie. « On n’est ni naïfs ni utopistes, notre bateau c’était le 36e d’une flottille qui est née en 2008 et dont seuls cinq d’entre eux ont rejoint les côtes de Gaza. Donc on imaginait bien que la probabilité d’un succès était assez faible. Mais elle n’était pas complètement nulle », affirme ce médecin de l’hôpital de la Timone à Marseille. « Avec les mobilisations en cours, on s’est dit qu’Israël nous laisserait peut-être accoster, en gage de conciliation », complète Pascal Maurieras, lui aussi Marseillais et marin à bord du navire. Ce n’est clairement pas le choix fait par l’État sioniste. En plein milieu des eaux internationales, l’armée israélienne arrête le bateau et son équipage dans la nuit du 8 au 9 juin. Les images feront le tour du monde. Retenu·es quelques jours dans les geôles d’Israël, les membres de l’embarcation finiront par être expulsé·es vers leur pays.
Durant leurs huit jours de traversée, ils ont pu établir plusieurs contacts en visioconférence avec des habitant·es de Gaza. « Ils nous ont dit combien c’était important pour eux de savoir que le monde les regarde et les soutient, de ne pas se sentir seuls face à un oppresseur qui régit leurs vies et leurs morts », relate Baptiste André, tout juste rentré à Marseille. Déjà, le départ d’un prochain bateau commence à s’organiser. « Si l’objectif n’est pas atteint cette fois non plus, alors nous recommencerons. C’est en accumulant les petites victoires, les luttes et la pression populaire que par le passé l’apartheid est tombé en Afrique du Sud ou que les Indiens se sont libérés de la puissance coloniale anglaise. Nous, simples citoyens, nous nous devons d’accentuer cette pression sur nos gouvernements », estime le médecin humanitaire, dans une profession de foi encourageante.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Lire « Sur la chaîne du génocide, il n’y a pas de petits maillons », CQFD n°230 (mai 2024).
2 Lire « Dockers de tous les pays, unissez-vous ! », CQFD n°204 (décembre 2021)
3 Opération de blocage, refus de charger des marchandises militaires à destination d’Israël, fouilles imposées de cargaisons, depuis juin 2024 des dockers de différents pays organisent des actions éparses lorsqu’ils sont informés du passage de munitions ou d’armes dans leur port.
Cet article a été publié dans
CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Dans ce numéro d’été, on se met à table ! Littéralement. Dans le dossier d’été, CQFD est allé explorer les assiettes et leur dimensions politiques... Oubliés le rosé et le barbeuc, l’idée est plutôt de comprendre les pratiques sociales autour de l’alimentation en France. De quoi se régaler ! Hors dossier : un mois de mobilisation pour la Palestine à l’international, reportage sur le mouvement de réquisition des logements à Marseille, interview de Mathieu Rigouste qui nous parle de la contre-insurrection et rencontre avec deux syndicalistes de Sudéduc’ pour évoquer l’assassinat d’une Assistante d’éducation en Haute-Marne...
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Par
Illustré par Manon Raupp
Mis en ligne le 05.07.2025
Dans CQFD n°243 (juillet-août 2025)
Derniers articles de Niel Kadereit