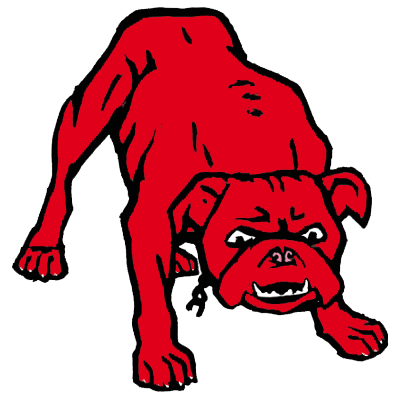Du célibat au racisme
« Le coaching en séduction n’est pas nouveau à l’extrême droite »
En 2010, le sociologue Samuel Bouron infiltre durant un an les Jeunesses identitaires, l’un des ancêtres de l’organisation Génération identitaire, dissoute par le gouvernement en 2021. Entre camps d’été, footings matinaux et coups de com’, il découvre les bases idéologiques sur lesquelles se regroupent les militants de cette mouvance et les alliances qu’ils tissent avec d’autres tendances d’extrême droite. On a échangé avec le chercheur, à partir de son essai Politiser la haine, la bataille culturelle de l’extrême droite identitaire (La Dispute, 2025), sur les actuelles recompositions stratégiques au sein de ce mouvement.
Peux-tu donner une définition de la mouvance identitaire ? En quoi ses conceptions se démarquent-elles des autres tendances d’extrême droite et de celles du Rassemblement national (RN) ?
« Ce courant se différencie du RN et, plus largement, des mouvances souverainistes et nationalistes, en plaçant l’identité au centre. Cette notion revêt un caractère essentialiste. Selon ses membres, le processus d’assimilation est impossible pour celles et ceux qui ne sont pas “Français de souche”. Contrairement au fascisme traditionnel et au nazisme, les identitaires ne procèdent pas à une hiérarchisation de morphotypes raciaux ; mais ils justifient la nécessité d’une épuration par l’incompatibilité entre certaines racines culturelles. Par ailleurs, alors que le RN défend une souveraineté exclusivement nationale, avec un programme qui prônait la sortie de l’Europe, les identitaires défendent une Europe blanche et indo-européenne et forment des alliances à échelle continentale.
« Pour “assainir” leur corps et leur esprit, les identitaires s’engagent donc dans un processus “d’enracinement” »
Autrefois, les différents groupuscules d’extrême droite étaient plus morcelés, mais à partir des années 2012-2013, lors des premières mobilisations de la Manif pour Tous, ils ont commencé à se considérer comme des alliés face aux musulmans, aux “wokes”, aux personnes LGBT... À cette période, les identitaires, qui disposent de locaux et de bars militants, et forment la mouvance la plus importante, renforcent leur réseau. Ces lieux deviennent alors un passage presque obligatoire pour les jeunes militants qui se politisent à l’extrême droite, y compris pour les élus du RN. »
Tu as infiltré les Jeunesses identitaires durant un an. Quel a été l’apport de ce travail de terrain, qui date maintenant d’il y a quinze ans, pour la rédaction de ton dernier ouvrage ?
« Je n’aurais pas pu construire les hypothèses décrites dans mon essai si je n’avais pas réalisé ces observations lors de cette immersion. J’ai notamment pu comprendre comment s’incarne leur pensée militante. Selon eux, le groupe racial et la nation forment un être vivant à épurer de ses éléments nocifs, qui contaminent la pureté du corps social, mais aussi biologique. Pour “assainir” leur corps et leur esprit, ils s’engagent donc dans un processus “d’enracinement”, qui consiste à se reconnecter à ce qu’ils conçoivent comme leur essence culturelle, fondamentalement blanche. Ils se perçoivent comme le dernier rempart face au “grand remplacement”. Ce “réenracinement” passe aussi par une “revirilisation”. Selon les identitaires, si la civilisation occidentale s’affaiblit face au “grand remplacement”, c’est aussi parce que les hommes se “féminiseraient”, comme l’affirmait une thèse issue du journaliste et théoricien d’extrême droite Guillaume Faye. Ils aspirent à une complémentarité entre les hommes et les femmes, ayant une essence différente, afin d’équilibrer la civilisation occidentale. Malgré leur dédiabolisation apparente, ces groupes sont encore structurés autour de la violence et de la virilité. Lors des camps d’été, la boxe est obligatoire et pratiquée quotidiennement. Le dernier jour, chaque militant se bat contre l’un de ses camarades. Ce tournoi fonctionne comme un rite de passage qui scelle définitivement l’arrivée dans le groupe. »
Comme tu le montres, la rhétorique masculiniste est une porte d’entrée vers l’extrême droite. Elle attire des jeunes, au départ peu politisés, mais sensibles à ces discours portés par des identitaires. Par exemple, Thaïs d’Escufon, l’ancienne porte-parole de Génération identitaire, utilise YouTube pour s’adresser à la communauté incel1. En 2021, dans le cadre d’un débat avec Alice Cordier, la dirigeante du collectif féministe identitaire Némésis, elle affirme défendre « la vision européenne d’une femme libre, mais qui a également une complémentarité avec l’homme européen et une place propre dans la famille ».
« La trajectoire de Thaïs d’Escufon est intéressante car elle n’a pas continué sa carrière en politique, comme l’ont par exemple fait Damien Rieux, membre de Reconquête, et Philippe Vardon, membre d’Identité-Liberté, mais elle a prolongé celle-ci sur les réseaux sociaux.
« Les fémonationalistes sont le vernis de modernité des discours identitaires »
Progressivement, elle s’est rapprochée des masculinistes en devenant “coach en séduction”, une activité qui représente une certaine manne économique et qui lui permet de déployer un discours raciste. Elle affirme notamment qu’elle n’entretiendra jamais de relation avec un homme non blanc. Le coaching en séduction n’est pas nouveau à l’extrême droite : en 1996 déjà, l’essayiste Alain Soral sortait Sociologie du dragueur, ouvrage dans lequel il prétend que les femmes ont une essence différente des hommes et qu’elles aiment être dominées et protégées. Pour multiplier les conquêtes, il faudrait rompre avec les idées féministes qui entrent insidieusement en nous, et assumer sa virilité profonde. L’idéologie fasciste rencontre ici celle du développement personnel : pour être heureux, il ne faut pas changer la société mais devenir la “meilleure version de soi-même”, un mantra que l’on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. »
Thaïs d’Escufon s’adresse surtout aux hommes mais le mouvement identitaire, autrefois très masculin, tente aujourd’hui de toucher un public plus féminin en prônant un féminisme identitaire. C’est notamment le rôle du collectif Némésis, créé en 2019. Quel rôle jouent des collectifs comme celui-ci, dans les actuelles recompositions au sein de la mouvance identitaire ?
« Quand j’ai commencé à enquêter, les femmes étaient marginales sur le plan numérique et elles acceptaient très peu de tâches d’encadrement. Mais désormais, les identitaires tentent de s’imposer à un public plus large. Pendant la Manif pour Tous, des groupes exclusivement féminins ont émergé, comme les Antigones, nées en 2013 en opposition aux Femen, connues pour leurs protestations publiques avec la poitrine dénudée sur laquelle sont écrits des slogans. Plus tard, des jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur créent le collectif Némésis. Ses militantes estiment aussi que les hommes et les femmes n’ont pas la même essence, mais défendent une égalité en droit. En effet, ces groupuscules sont contraints de s’adapter aux avancées féministes conquises par les luttes sociales de ces dernières années. Elles rejoignent les obsessions identitaires concernant les musulmans et les personnes non blanches qu’elles perçoivent elles aussi comme des ennemis. Le viol, par exemple, serait selon elles principalement commis par des étrangers. La professeure en sociologie Sarah Farris qualifie de “fémonationaliste” ce type de féminisme structuré par un cadrage nationaliste à des fins racistes. Ces militantes sont le vernis de modernité des discours identitaires. Aujourd’hui, on voit même de nombreux partis d’extrême droite européens dirigés par des femmes. Les fémonationalistes bénéficient d’un écho médiatique en trouvant des relais au sein des élites politiques : Bruno Retailleau a notamment affirmé récemment qu’il partageait le “combat” de Némésis. Néanmoins, le féminisme identitaire ne s’étend pas vraiment dans la population et la jeunesse. Les idées féministes gagnent plus de terrain que celles des identitaires ! »
1 La culture incel (involutary celibate) désigne celle des communautés en ligne d’hommes se définissant comme des célibataires involontaires. Ils cultivent la violence et le ressentiment envers les femmes qui seraient responsables de leur misère affective et sexuelle.
Cet article a été publié dans
CQFD n°241 (mai 2025)
Dans ce numéro, on se penche sur le déni du passé colonial et de ses répercussions sur la société d’aujourd’hui. Avec l’historien Benjamin Stora, on revient sur les rapports toujours houleux entre la France et l’Algérie. Puis le sociologue Saïd Bouamama nous invite à « décoloniser nos organisations militantes ». Hors dossier, on revient sur la révolte de la jeunesse serbe et on se penche sur l’enfer que fait vivre l’Anef (Administration numérique des étrangers en France) à celles et ceux qui doivent renouveler leur titre de séjour.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°241 (mai 2025)
Par
Illustré par Baptiste Alchourroun
Mis en ligne le 18.05.2025