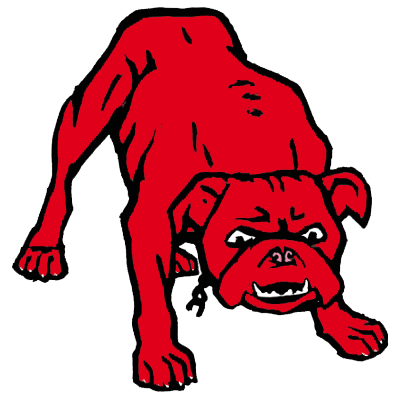À nos Samis
L’autre piste des larmes
« Un peu de hautes herbes et des pierres moussues. De vagues cercles de tourbe […]. Il y a bien longtemps, des goađit, les tentes samis1, se trouvaient là, des enfants gambadaient… Est-ce que j’ai le droit de regretter un lieu qui n’a jamais été mien ? » Elin Anna Labba arpente les parages désertés de la côte norvégienne où ses ancêtres vivaient autrefois plusieurs mois par an, sur les pâturages d’été de leurs rennes. Ce paysage, elle en vient mais elle ne le connaît pas : dans les années 1920, les centaines de familles samis qui estivaient en Norvège furent déplacées de force en Suède, sans possibilité de retour. Paru là-bas en 2020, son livre Vies de Samis – Les déplacements forcés des éleveurs de rennes (CNRS éditions) raconte leur histoire. Le titre français2 ne rend pas justice au bouleversant collage de récits, de paroles, de chants, de photographies et de documents réunis par son autrice. Dans son dialecte, « se souvenir » et « raconter » sont presque le même mot, explique-t-elle : « Nous nous souvenons de ceux dont nous racontons l’histoire. »
Au nord du cercle arctique, au pays des aurores boréales et du soleil de minuit, les Samis pratiquent l’élevage semi-nomade des rennes, dont ils suivent les troupeaux dans leurs migrations saisonnières. Cette itinérance déplaît aux États scandinaves qui colonisent peu à peu ces confins peu peuplés mais riches en minerais. En 1919, la Suède et la Norvège signent une convention réglementant les déplacements des rennes d’un pays à l’autre : derrière un langage neutre et technique, il s’agit d’interdire aux Samis de quitter les forêts suédoises où ils passaient l’hiver pour rejoindre les fjords et les îles norvégiennes, au nord, où ils remontaient en été. L’État suédois s’avisant que les Samis et leurs rennes sont désormais trop nombreux dans la zone frontalière, il organise une nouvelle déportation dans le Västerbotten, à plusieurs centaines de kilomètres au sud.
Les Samis ont perdu en chemin un rapport au monde plus ancien que la raison calculatrice des États et du capital, où le territoire n’est pas ordonné par les cartes, les lois et les titres de propriété mais par la connaissance experte des pistes qu’empruntent les bêtes, et où le paysage est composé d’êtres vivants qu’ils célèbrent par le chant joik qu’ils leur adressent. Les Samis joikent les personnes et les bêtes, les montagnes, les buissons de mûres boréales qui poussent dans les tourbières. À leur arrivée, ils chantent la joie de la rencontre ; lorsqu’ils partent, la tristesse de les quitter. Chassés de ces terres qu’ils aimaient, ils disent « adieu aux buissons, aux arbres et aux pierres… » Aux paysages inconnus qu’ils découvrent, ils n’ont rien à dire ; ce sont des étrangers : « Ils n’ont jamais vu des arbres aussi hauts. » Les rennes ne sont pas moins désorientés et s’enfuient irrésistiblement, par milliers, vers le nord, se perdent ou se noient dans ces rivières qu’ils ignorent – causant la ruine de leurs propriétaires.
À la même époque, des savants suédois mesurent les crânes des Samis dans des instituts de « biologie raciale » ; mais, de ce qu’ils ont dans la tête, les États ne savent que ce qui est nécessaire à les sédentariser et les assimiler linguistiquement et culturellement. Un siècle plus tard, les États scandinaves ont reconnu des droits collectifs au peuple sami mais continuent de le spolier ; et le racisme anti-Samis se porte toujours bien en Suède3. Dans le récit dominant, la mémoire de leur déportation s’est perdue comme celle des Amérindiens sur la Piste des larmes. En ressuscitant ces voix et ces visages oubliés, Vies de Samis leur rend justice – et relance l’écho de leur joik qui résonne encore dans les montagnes.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Les Samis, ou Sames, étaient autrefois connus sous le nom suédois de « Lapons », qu’ils rejettent aujourd’hui.
2 En suédois, Les Maîtres nous ont placés ici.
3 C’est le thème du roman d’Ann-Hélen Laestadius Stöld (Robert Laffont, 2022).
Cet article a été publié dans
CQFD n°219 (avril 2023)
Depuis le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites, la France est en ébullition : blocages, grèves, manifs monstres et poubelles en feu ! Impossible de ne pas consacrer une très large part de notre numéro d’avril à cette révolte printanière. De Marseille à Dieppe, de Saint-Martin-de-Crau à Sainte-Soline, de la jeunesse en mouvement à la répression en roue libre, des travailleuses du sexe en lutte à l’histoire du sabotage... Reportages, analyses, entretiens. De quoi alimenter, on l’espère, la suite des mobilisations !
On vous emmène tout de même un peu hors de nos frontières (ou presque) : En Kanaky-Nouvelle-Calédonie, où la France poursuit sa démolition du processus de décolonisation, en Turquie où la solidarité populaire a pallié aux manques de l’État après les séismes début février et en Tunisie dans un musée particulier.
Je veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°219 (avril 2023)
Par
Illustré par Thibaut Trincklin
Mis en ligne le 09.05.2023
Dans CQFD n°219 (avril 2023)
Derniers articles de Laurent Perez