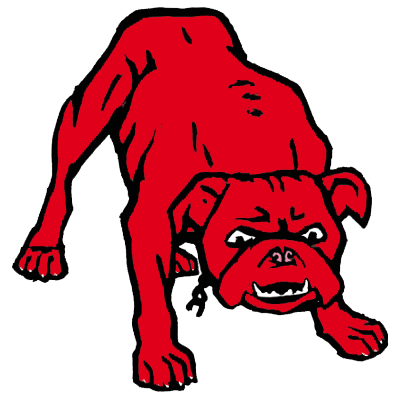Aurait-on un passé colonial ?
« Il faut que la société consente à cette histoire »
L’énième crise diplomatique entre l’Algérie et la France est l’occasion, pour certains de nos responsables politiques, de réinvestir le lexique et la posture coloniale de nos aïeux. Au hasard, octobre 2024 : alors que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, se félicite que la France ait reconnu le Sahara occidental comme étant marocain (pomme de discorde avec le voisin algérien), il croit bon de préciser vouloir « accroître [son] action consulaire et culturelle sur ce territoire ». Ou encore, janvier 2025 : les médias français défendent comme un Voltaire Boualem Sansal, dissident du régime algérien et arrêté par ce dernier pour avoir entre autres expliqué au magazine d’extrême droite Frontières qu’il « est facile de coloniser des petits trucs qui n’ont pas d’histoire ». Plus récemment, le 16 avril dernier : pendant que sur CNews, le bandeau d’actualité annonce « Algérie : enfin de la fermeté », sur Europe 1, le ministre de la Justice Gérald Darmanin précise que « le passé est le passé et la France n’a pas à s’en excuser », avant de proposer de baisser les visas accordés aux Algériens et d’augmenter le nombre des OQTF. Sans parler de la posture infecte de surplomb du président Macron lui-même à Mayotte et en Kanaky.
Derrière nous le déni colonial ? Franchement non. On en parle avec Benjamin Stora, historien, spécialiste des questions mémorielles franco-algériennes.
⁂
Après la décolonisation, l’Algérie comme la France ont construit, chacun de son côté, un récit national. Sur quels imaginaires ?
« De nombreux pays en Europe, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont cherché au XIXe siècle à se légitimer comme États-nations1. La France et l’Algérie n’échappent pas à cette règle. Le récit national français s’est construit autour d’un certain nombre de principes universalistes hérités de la Révolution de 1789, comme ceux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais il s’est aussi construit sur la mise en valeur de son empire colonial, qui a repoussé les frontières de son espace géographique.
« Bruno Retailleau s’arroge tous les droits qu’avait un ministre régalien à l’époque de l’Algérie française »
Du côté de l’Algérie, le récit national s’est fabriqué autour de la libération du joug de la France coloniale. Sans regretter l’Empire ottoman auquel elle a jadis appartenu, l’Algérie contemporaine construit son roman national autour de la repossession d’une souveraineté perdue. Nous avons donc, d’un côté, un imaginaire français empreint d’une nostalgie de l’Empire, et de l’autre, un imaginaire algérien dont le point de départ est la guerre de libération nationale qui aboutit à l’Indépendance de 1962. Le récit algérien s’appuie sur une valorisation extrême d’une culture de la guerre au détriment d’une culture politique démocratique. »
Quand Bruno Retailleau dit que « rien ne donne le droit à l’Algérie d’offenser la France », quels concepts mobilise-t-il ?
« La question est surtout “qui parle ?”. Ici, c’est un ministre de l’Intérieur qui s’exprime et non pas un ministre des Affaires étrangères. Or, pendant 130 ans, l’Algérie était considérée comme un département français, géré par le ministre de l’Intérieur – pas par le ministre des Colonies, encore moins par celui des Affaires étrangères. Cela fait donc ressurgir le souvenir d’une gestion de l’Algérie comme un territoire français. Cette résurgence d’une domination ancienne est plus problématique que tout le reste : Bruno Retailleau s’arroge tous les droits qu’avait un ministre régalien à l’époque de l’Algérie française. »
Le journaliste Jean-Michel Aphatie a déclaré fin février :« Nous avons fait des centaines d’Oradour-sur-Glane en Algérie », comparant ce massacre d’un village entier par une division SS, le 10 juin 1944, à ceux d’Algériens commis par la France coloniale, ce qui a suscité un tollé énorme. On peut parler de déni ?
« Dans mon livre La Gangrène et l’oubli, sorti en 1991, j’expliquais que le récit national français a longtemps été basé sur une occultation du passé colonial, et tout particulièrement de la guerre d’Algérie. Il a fallu forcer le blocus de l’amnésie générale en travaillant sur cette guerre et la réhabiliter. Ce n’est qu’au début des années 2000 qu’on a commencé à tirer le fil de cette mémoire pour tenter de la retrouver. Mais le problème c’est qu’on ne peut pas comprendre la fin d’un film si on n’en connaît pas le début. Il fallait remonter aux origines de cette colonisation, à savoir la guerre de conquête au XIXe siècle. Une époque que les historiens documentaient depuis très longtemps mais qui n’était ni enseignée, ni transmise. En parlant ainsi, Jean-Michel Aphatie n’a fait que lever le voile sur ce que cette conquête a toujours été : exceptionnellement sanglante, faite de massacres, d’enfumades, d’expropriations de terrains, de déplacements de population… »
L’année 2030 marquera les deux siècles du début de cette conquête. Selon vous, tenons-nous encore ce passé sous silence ?
« C’est relatif, ce silence. Il y a de nombreuses productions littéraires et filmiques à ce sujet. On peut citer les romans de Mathieu Belezi, par exemple Attaquer la terre et le soleil (2022) et Moi, le glorieux (2024), mais aussi le prix Goncourt décerné au roman L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni en 2011. Le problème se situe davantage dans l’acceptation de ces images et de ces écrits, par la population française. Il faut que la société consente à cette histoire. La question de la transmission est donc centrale, notamment à travers l’institution scolaire. Toute histoire nationale doit sans cesse être revisitée. Il faut l’enrichir, la perfectionner, sous peine de créer des histoires définitives, officielles. On n’en est pas encore là en France. Même si bien sûr, un certain nombre de faits ont été établis et que la question coloniale, très peu étudiée il y a 30 ou 40 ans, l’est beaucoup plus aujourd’hui.
« Il y a un décalage énorme entre ces jeunes qui aspirent à plus d’histoire et une classe politique dans le déni éhonté. »
C’est logique : la jeunesse issue des immigrations post-coloniales est très consciente de cette histoire et a un fort désir de connaissance à son sujet. Avant, peu de gens travaillaient là-dessus : le sujet était vu comme périphérique, contrairement à des sujets comme le socialisme, la lutte des classes, le mouvement ouvrier, etc. »
Quelles voix vont permettre aujourd’hui de réexaminer cette histoire ?
« La génération des années 1990-2000, issue des immigrations post-coloniales, a poussé en avant la nécessité de la réhabilitation de la mémoire coloniale. Les citoyens ont besoin d’établir leurs généalogies afin de comprendre d’où ils viennent. Il y a un décalage énorme entre ces jeunes qui aspirent à plus d’histoire – et veulent en particulier connaître celle de leurs parents ou grands-parents – et une classe politique dans le déni éhonté. Le rapport sur la colonisation que j’ai fait en 20212 n’a pratiquement pas été discuté par la classe politique française. Sans surprise, la droite et l’extrême droite l’ont condamné. Mais la gauche ne s’en est pas non plus emparée. Un exemple parmi d’autres : la reconnaissance par la France de l’assassinat en pleine guerre d’Algérie de Maurice Audin (mathématicien membre du Parti communiste algérien), Larbi Ben M’hidi (responsable des indépendantistes du FLN) et Ali Boumendjel (avocat et militant pour l’indépendance), qui étaient tous de grands nationalistes algériens, n’a jamais été discutée.
Mais ce fossé ne pourra pas subsister longtemps. De plus en plus de jeunes issus de cette histoire accèdent à des responsabilités politiques, à des fonctions de chercheurs, d’intellectuels. Ils emmènent avec eux leurs bagages d’histoires subjectives. Le moment où nous devrons faire face à ces héritages se rapproche. Bientôt, la classe politique ne pourra plus tourner la tête. »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Sur les raisons qui ont poussé la bourgeoisie à construire cet imaginaire national, voir pages 4 et 5 de ce numéro « Décoloniser nos organisations militantes ».
2 Rapport intitulé Les Questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie.
Cet article a été publié dans
CQFD n°241 (mai 2025)
Dans ce numéro, on se penche sur le déni du passé colonial et de ses répercussions sur la société d’aujourd’hui. Avec l’historien Benjamin Stora, on revient sur les rapports toujours houleux entre la France et l’Algérie. Puis le sociologue Saïd Bouamama nous invite à « décoloniser nos organisations militantes ». Hors dossier, on revient sur la révolte de la jeunesse serbe et on se penche sur l’enfer que fait vivre l’Anef (Administration numérique des étrangers en France) à celles et ceux qui doivent renouveler leur titre de séjour.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°241 (mai 2025)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Djaber
Mis en ligne le 05.05.2025
Dans CQFD n°241 (mai 2025)
Derniers articles de Inès Atek