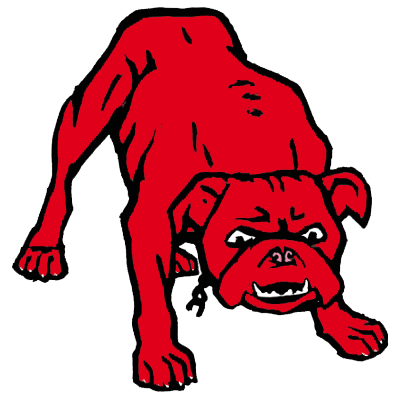Le turbin au gnouf
Exploiter la main-d’œuvre captive
Sous la Restauration, une ordonnance de 1814 visait à établir dans les prisons « un régime propre à corriger les habitudes vicieuses des criminels […], les préparer par l’ordre, le travail et les instructions religieuses et morales à devenir des citoyens paisibles et utiles à la société ».
Mais en réalité, selon Michel Foucault, il ne s’agissait pas de former des compétences à un métier : « À partir de 1835-1840, il est devenu clair qu’on ne cherchait pas à redresser les délinquants, à les rendre vertueux, mais à les rassembler dans un milieu bien défini, fiché, qui puisse être une arme à des fins économiques ou politiques. Le problème alors n’était pas de leur apprendre quelque chose, mais au contraire de ne leur apprendre rien, pour être bien sûr qu’ils ne pourront rien faire en sortant de la prison. 1 » Dans l’esprit utilitariste de l’enfermement moderne, l’idéal de réinsertion philanthropique avait vécu.
Aujourd’hui, Service-public. fr, le site officiel de l’administration française, affirme ce qui suit : « Les personnes détenues peuvent travailler en prison, si elles le souhaitent. L’administration pénitentiaire n’a pas l’obligation de leur procurer du travail, mais elle doit s’efforcer de le faire. […] Les règles du Code du travail ne s’appliquent pas à cette situation. » De fait, tous s’accordent à le dire : le turbin en zonzon est une zone de non-droit. Le tarif de rémunération est toujours dans un tiers des cas fixé à la pièce, contournant la loi du 24 novembre 2009 (qui avait introduit le principe de la rémunération horaire) : « Ça fait mal de remonter en cellule après cinq heures de travail pour quatre, cinq ou au maximum onze euros 2 », expliquait un détenu dans un courrier à l’Observatoire international des prisons (OIP) en novembre 2017. La même année, le journal lillois La Brique épinglait ainsi le tâcheronnage auquel avait recours l’entreprise Pocheco, modèle d’entreprise « responsable, écologique et citoyenne » pour certains, qui faisait façonner ses enveloppes par des prisonniers de la maison d’arrêt de Douai, payés en moyenne 1,50 € l’heure 3...
Depuis 1987 et la réforme Chalandon, la privatisation partielle des prisons a accéléré la passation du travail pénitentiaire et de la formation professionnelle sous la coupe du management privé. En trente ans, le taux d’activité carcérale rémunérée a pris le pli néolibéral des sociétés occidentales. En 1996, Bob Tessler, un entrepreneur californien, en résumait l’esprit : « Nous avons là une main-d’œuvre captive, des hommes qui sont motivés, qui veulent travailler. C’est ce qui rend le système rentable. Nous ne payons pas de charges sur les salaires, pas de congés payés ni de congés maladie.4 » Pour les boîtes privées, rien de tel pour rester compétitif dans la jungle de la mondialisation que de baisser les coûts de production en ayant recours au travail carcéral. « C’est mieux qu’un atelier clandestin, ça coûte moins cher et les bénéfices sont multipliés 5 », commente Abdelkrim, un ex-taulard de Draguignan (Var).
Cette « industrie de la punition » a-t-elle tout avalé ? Alors que le plan pénitentiaire de Macron prévoit la création de 15 000 places en dix ans, la garde des Sceaux envisage de lancer des prisons expérimentales centrées autour du travail : « Les entreprises investiront dans la formation des détenus. Elles pourront embaucher à terme les personnes qu’elles auront formées.6 » Des réservoirs de main-d’œuvre captive en somme...
Autre piste pour rentabiliser les taules : début octobre 2018, neuf députés, dont Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, ont proposé une loi « visant à instaurer une contribution obligatoire aux frais d’incarcération des détenus » en prenant l’argent sur les biens propres du prisonnier ou en faisant payer sa famille si celui-ci est mineur. Et ce afin « d’alléger le coût de fonctionnement des prisons pour le contribuable et en même temps de responsabiliser et réinsérer les détenus par le travail », travail redevenu obligatoire… L’imagination punitive n’a pas de limite.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 In « Entretien sur la prison : le livre et sa méthode », Dits et écrits, tome II, Gallimard, 1994.
2 « Travail en prison : la servitude organisée », sur le site Oip.org (13/02/2018).
3 « Pocheco : lettre verte non recommandée », labrique.net (05/07/2017).
4 Cité dans une anthologie de textes contre l’enfermement : Au pied du mur, 765 raisons d’en finir avec toutes les prisons, L’Insomniaque, 2000.
5 Idem.
6 Le Parisien (18/10/2018).
Cet article a été publié dans
CQFD n°177 (juin 2019)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°177 (juin 2019)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Cécile Kiefer
Mis en ligne le 27.11.2019
Dans CQFD n°177 (juin 2019)
Derniers articles de Mathieu Léonard